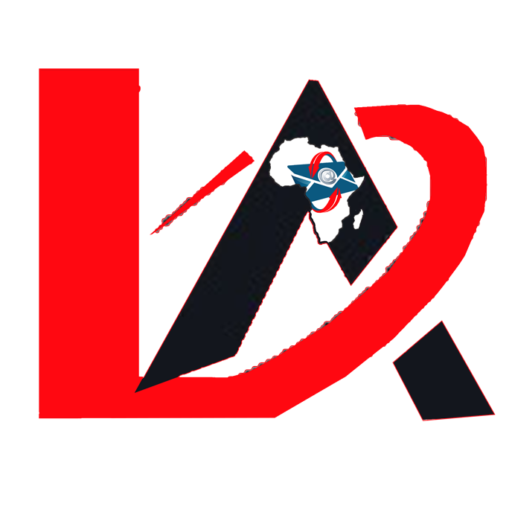L’opération « Dougoukoloko », dirigée dans sa partie orientale par le Général de brigade Massaoulé Samaké, amorce un tournant décisif dans la sécurisation des zones aurifères stratégiques du Mali. Quelques jours seulement après l’avertissement ferme lancé aux exploitants clandestins de la mine d’or de N’tahaka, un retrait progressif mais visible est constaté sur le terrain. Une évolution qui témoigne de la portée de l’initiative et de la nouvelle stratégie sécuritaire de l’État.
Située à proximité immédiate de la Commune urbaine de Gao, la mine de N’tahaka était devenue un point névralgique de l’orpaillage illégal, attirant orpailleurs clandestins, trafiquants, et parfois même des groupes armés. Mais depuis la déclaration sans appel du Général Samaké, le site connaît une accalmie inhabituelle: le flux de véhicules suspects et d’allées et venues désordonnées a fortement diminué.
Des dizaines d’orpailleurs, redoutant une intervention militaire imminente, ont quitté la zone, confirmant que le message des autorités est en train de porter ses fruits. Un témoin local, préférant garder l’anonymat, souligne : « Ceux qui sont partis ont compris qu’il n’y aurait pas de deuxième avertissement. »
Un enjeu sécuritaire et économique majeur
Au-delà de la sécurisation du site, l’opération vise à réaffirmer l’autorité de l’État sur les ressources stratégiques. Le Général Samaké a rappelé que l’orpaillage illégal constitue non seulement une perte économique colossale pour le pays, mais alimente également des réseaux criminels et terroristes.
L’objectif est double : tarir les sources de financement illicites dans une région instable, et restaurer un contrôle légal sur une activité économique cruciale pour les recettes nationales.
L’approche adoptée par les autorités maliennes dépasse la simple opération de force. Elle s’inscrit dans une vision plus large de structuration du secteur minier, comme l’explique un expert en gouvernance minière: « Il ne s’agit pas uniquement de chasser les orpailleurs. L’État veut encadrer l’exploitation, percevoir les taxes et garantir le respect de l’environnement et des droits sociaux. »
Cette dynamique pourrait permettre à terme d’intégrer durablement les ressources aurifères dans l’économie formelle, au bénéfice des populations locales et de l’État.
La mine de N’tahaka devient un test de crédibilité majeur pour les autorités de la Transition. Leur capacité à tenir dans la durée, à empêcher le retour des exploitants illégaux, et à reconstruire un environnement économique sécurisé y sera scrutée de près. Si ce modèle réussit, il pourrait être répliqué sur d’autres sites illégaux à travers le pays.
Mais la prudence reste de mise. Certains réseaux bien implantés pourraient tenter de résister ou de contourner la pression militaire. La suite de l’opération « Dougoukoloko » sera donc décisive pour asseoir durablement l’autorité de l’État dans les zones à enjeux.
Cette première phase de retrait à N’tahaka marque une victoire tactique pour les FAMA, mais le véritable défi sera la consolidation des acquis et la mise en place d’un encadrement institutionnel pérenne. À travers cette opération, c’est une nouvelle approche de gouvernance des ressources naturelles que le Mali tente d’imposer : rigueur, légalité et souveraineté.
Par Sanadé Sanah