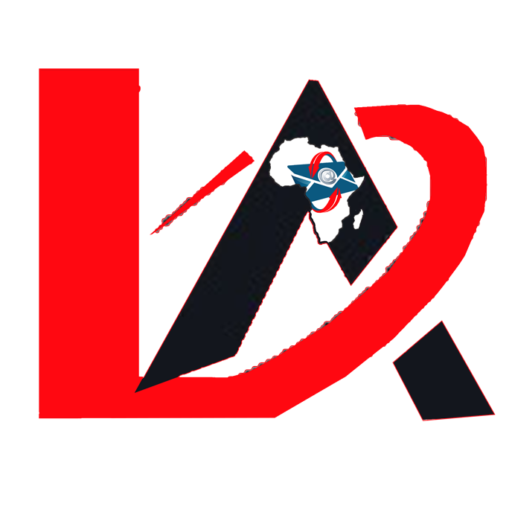La Fondation Merck a tenu les 18 et 19 juin la 7ᵉ édition du Sommet de l’Initiative des Premières Dames (MFFLI), une rencontre virtuelle de haut niveau rassemblant 14 Premières Dames d’Afrique et d’Asie, des décideurs politiques, des experts en santé et des partenaires stratégiques. Ce sommet a été suivi d’une formation pour les médias sur les enjeux de la santé.
La vision de la Fondation Merck a toujours été simple mais profondément transformatrice : permettre à chacun de vivre une vie saine et épanouie. Cette vision n’est pas simplement un énoncé de mission ; elle est le fondement de tous nos efforts stratégiques. En guidant notre mission, nous nous engageons à renforcer les capacités dans le secteur de la santé à travers des initiatives allant des campagnes de sensibilisation à la recherche innovante. Nous croyons fermement que chaque individu mérite l’accès à des soins de santé de qualité. Dans cette quête, nous œuvrons pour transformer les systèmes de soins de santé, en nous attaquant aux barrières qui limitent l’accès aux services, notamment dans les zones les plus vulnérables.
Un des défis majeurs auquel nous faisons face est la stigmatisation liée à l’infertilité, un obstacle qui touche de nombreuses femmes sur le continent africain. En sensibilisant le public et en offrant des programmes éducatifs, nous cherchons à briser ces tabous et à offrir un soutien tangible à ceux qui en ont besoin. En outre, nous sommes fiers de notre engagement à autonomiser les femmes, qui sont souvent les piliers de leurs familles et de leurs communautés. À travers nos programmes, nous encourageons la promotion de l’éducation des filles, car nous croyons que l’éducation est la clé pour un avenir prometteur. Cela passe par des bourses, des ateliers et des campagnes de sensibilisation visant à souligner l’importance de l’éducation pour toutes les filles, sans exception.
Dr. Rasha Kelej a souligné l’importance de cet événement, qui représente une occasion cruciale de renforcer la solidarité et l’engagement au sein de la communauté internationale. Elle a mis en avant la présence de nouvelles Premières Dames, notamment celles du Ghana, du Mozambique, du Nigeria et du Sénégal, qui apportent avec elles des perspectives et des expériences uniques. « Bienvenue sur notre plateforme de l’Initiative des Premières Dames d’Afrique de la Fondation Merck. Nous avons hâte de collaborer plus étroitement avec vous à l’avenir, » a-t-elle exprimé avec enthousiasme, encourageant un dialogue ouvert entre toutes les parties présentes. Ce rassemblement est bien plus qu’un simple sommet ; il symbolise ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous unissons autour d’une vision et d’un objectif commun, transcendant les frontières et les différences culturelles pour faire avancer la santé en Afrique.
Avant de poursuivre, elle a précisé que tous nos programmes au cours des 13 dernières années ont été lancés avec succès sur cette même base d’engagement et de collaboration. Nous célébrons aujourd’hui le huitième anniversaire de la Fondation Merck et le treizième anniversaire de nos programmes de développement, une étape importante qui témoigne des années d’engagement, de partenariats fructueux et de changements significatifs dans la vie de millions de personnes. Ce succès est particulièrement perceptible dans les communautés les plus vulnérables et mal desservies, où nos initiatives ont véritablement fait la différence, en offrant non seulement des soins, mais aussi de l’espoir et des opportunités.
Dr. Kelej a également fait mention de notre programme de bourses, l’un des plus impactants, qui a aidé de nombreux professionnels de santé à développer leurs compétences et à améliorer la qualité des soins offerts. Avec des résultats tangibles, le programme a permis à des centaines d’étudiants et de jeunes médecins d’acquérir une formation précieuse, essentielle dans un contexte où la demande de soins de santé de qualité est en constante augmentation. « Ce programme est un catalyseur essentiel pour transformer le paysage des soins de santé dans le secteur public, » a-t-elle déclaré avec conviction. « Une population en bonne santé est la base d’une nation forte et prospère, et il est impératif que nous continuions à investir dans le développement de notre capital humain, car cela garantira un avenir meilleur pour tous. » Elle a enfin encouragé toutes les parties prenantes à s’impliquer davantage pour créer un écosystème favorable aux progrès dans le domaine de la santé.

Elle a poursuivi en soulignant que le manque de ressources financières n’est pas le seul défi auquel l’Afrique est confrontée. Un problème plus urgent et tout aussi décisif est le manque de professionnels de santé qualifiés capables de prévenir, diagnostiquer et traiter efficacement les maladies qui touchent la population. Cette pénurie de personnel médical représente l’un des obstacles majeurs à l’accès à des soins de santé de qualité sur le continent, mettant en péril les vies de millions de personnes. En effet, selon le Rapport Mondial sur la Santé 2024, l’Afrique ne compte que 268 écoles de médecine publiques, avec certains pays n’en ayant qu’une seule ou d’autres aucune, ce qui souligne les énormes lacunes dans la formation des praticiens médicaux.
De plus, comme le souligne le rapport de l’OMS de 2021, l’Afrique supporte 24 % de la charge mondiale de morbidité, mais ne compte que 2,91 professionnels de santé pour 1 000 habitants. Cette statistique alarmante crée un déséquilibre qui est aggravé par une répartition inégale du personnel entre les zones urbaines et rurales. Dans les régions reculées, les populations sont souvent laissées sans accès à des soins de santé appropriés, entraînant une détérioration de la santé publique et une augmentation des taux de mortalité évitables. Ce déficit en personnel médical a un impact profond sur les résultats sanitaires, freinant les progrès vers des objectifs de santé durables et de qualité.
Avant le lancement de nos programmes en 2012, des pays comme la Gambie, le Libéria, ou la République centrafricaine avaient très peu de médecins spécialisés dans des domaines cruciaux tels que l’oncologie, la fertilité, les soins respiratoires, la réanimation ou la gynécologie, ce qui laissait des lacunes béantes dans les soins offerts à la population. La situation était d’autant plus critique que les quelques médecins présents étaient souvent submergés par la charge de travail et manquaient de formation spécifique. Depuis 2012, la Fondation Merck, en collaboration avec ses partenaires, a renforcé considérablement les capacités sanitaires en offrant plus de 2 270 bourses (masters d’un ou deux ans) à des médecins qualifiés de 52 pays dans 44 spécialités médicales critiques. Grâce à cette initiative, un nouveau souffle est donné à la formation des professionnels de santé, ce qui contribue non seulement à améliorer les conditions de santé actuelles, mais aussi à bâtir une infrastructure médicale pérenne pour les générations futures.

Ces spécialités incluent notamment l’oncologie, la diabétologie, et la cardiologie, des domaines vitaux qui touchent des millions de personnes à travers le monde. Grâce à cette initiative, de nombreux médecins formés deviennent les premiers spécialistes dans leurs domaines respectifs au sein de leurs pays, apportant une expertise qui était autrefois inaccessible. Chaque diplômé, armé de nouvelles compétences et de connaissances de pointe, retourne dans son pays d’origine, où il se consacre à la prise en charge de plus de 1 000 patients par mois. Ces patients, qui n’avaient auparavant aucun accès à des soins spécialisés, bénéficient désormais de traitements cruciaux, des diagnostics précoces, et d’un suivi médical régulier, transformant ainsi leur qualité de vie et, dans de nombreux cas, leur survie.
En plus de leurs compétences cliniques, ces médecins jouent un rôle central dans la sensibilisation et l’éducation de leur communauté. Ils organisent des campagnes de prévention, prodiguent des conseils de santé et travaillent en étroite collaboration avec d’autres professionnels de la santé pour créer un réseau de soutien qui dépasse les seules frontières de leurs cliniques. Cela favorise un écosystème de santé durable qui peut répondre aux besoins croissants de la population.
Par Bréhima Traoré