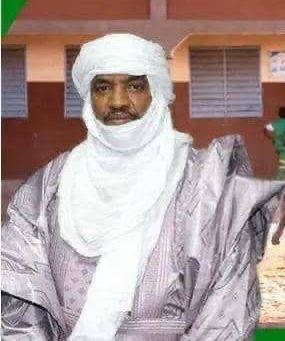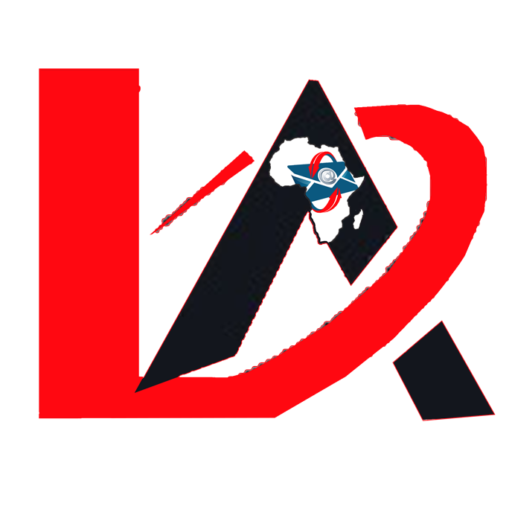Le débat constitutionnel pour le Mali nouveau
Enfin, l’ancien ministre de la Refondation explique :
« On pourra difficilement avancer avec le nouveau projet constitutionnel, œuvre de nature politique, en le confiant à des groupes de personnes choisies sur la base d’une logique de technicité et de représentation sociale. On passe forcément à côté, car ce n’est pas l’objet ».
Notre patrie est atteinte. La Nation, fruit d’une construction millénaire, est sérieusement menacée de désagrégation. Pathologies, convulsions et crises se disputent sa santé et son intégrité, sur le fil des dérives de la mal gouvernance dans la durée, avec les malhonnêtes à la manœuvre. Le mal d’État, produit de l’ignorance, de l’incompétence et autres dérèglements accidentels, aggrave ce tableau clinique.
Les aléas de l’ouvrage de la nouvelle Constitution
Les écueils de l’élaboration de la nouvelle Constitution attestent que ce travail a abouti à un papier encore plus polémique que ne l’était l’ancienne. Le texte concocté se caractérise par des reculs et des non-sens, déjà signalés. On parle donc de finaliser un projet a priori non viable, et qui n’est pas conforme aux attentes. Attention !!!
J’ai dit et je le redis, les Constitutions ne sont pas des produits d’une alchimie de spécialistes du droit. Nenni ! Elles sont, de façon générale, le fait des nouvelles forces montantes, combattantes, acquises au changement profond de l’ordre ancien. Elles sont porteuses d’une nouvelle vision de la collectivité, d’un projet de société dont le nouvel acte serait la traduction.
Un acte constitutionnel est, en principe, l’émanation d’une convention écrite, ou orale, de consécration des valeurs vivifiante d’une société, des règles fondamentales d’existence de la nation. D’après l’économiste sénégalais Sanou Mbaye « Pour bon nombre de pays d’Afrique noire, l’Occident est devenu la référence absolue. Tout se passe comme si copier et se soumettre au modèle occidental était devenu une inclination inéluctable ».
Dans le cas malien présent, on pourra difficilement avancer avec le nouveau projet constitutionnel, œuvre de nature politique, en le confiant à des groupes de personnes choisies sur la base d’une logique de technicité et de représentation sociale. On passe forcément à côté, car ce n’est pas l’objet. On spéculera sur des termes de révision, d’amendement, de reformulation, pour prétendre en obtenir une nouvelle constitution.
Chacun des concepts avancés a du sens
Lorsque les Maliens se sont dressés contre les forfaitures du régime d’alors et le système de prédation et de pillage dans la durée instauré par des partis et politiciens véreux, le leadership de la mobilisation a défini les objectifs de lutte, résumés en termes de refondation nationale, de gouvernance vertueuse, de Malikura. Chacun de ces concepts a du sens. L’idée derrière la visée était l’option pour un nouveau contrat social de réengagement citoyen, l’expression d’une volonté de rupture pour l’émergence d’un Mali nouveau.
Parlant donc de nouvelle Constitution, il faut comprendre qu’il ne s’agit pas de rédiger simplement une autre Constitution par des experts, assistés de quelques citoyens, mais surtout d’élaborer une Constitution autre, une Constitution nouvelle s’entend, cadre normatif de couvaison d’une citoyenneté de type nouveau.
Faire confectionner une loi fondamentale par d’autres acteurs que ceux opérant résolument sur le front politique du changement, en l’absence des sources d’inspiration et maîtres à penser, donnera ce que ça donnera. Il va falloir, à n’en pas douter, y revenir demain et reprendre, car il ne s’agit pas de se contenter ou de s’accommoder à défaut. Du moment que l’alternative n’a pas été envisagée.
L’élaboration d’une Constitution, je l’ai déjà dit, se fait à trois niveaux :
- La voie parlementaire régulière
- Le choix d’un collège, soit élu ou délégué
- La voie gouvernementale.
Mais, c’est une fausse illusion de croire que la conception d’une Constitution, autre que la décalque, soit à la portée du premier juriste, diplômé de droit, magistrat, avocat ou professeur. Que non ! Et, ce n’est pas parce que quelqu’un a tenu un beau discours de ses lectures, ou sur la Charte de Kurukanfuka, critiquée ou exaltée, mystifiant l’inculture des ignorants du domaine, qu’il se qualifie pour cette tâche éminemment politique.
Le syndrome de nos élites complexées
La domination occidentale s’est soldée chez les éduqués dans leur école par l’éclipse totale du référentiel endogène, la substitution d’un imaginaire de conditionnement, des effets culturels inoculant divers complexes : celui du maître, de la langue, du savoir-faire, de la rationalité, de la preuve matérielle, de la source et de la reconnaissance. Tant et si bien que pour les élèves dociles « la vérité sonne blanche » (dixit Cheick Anta Diop). En conséquence, nous contestons à notre semblable africain son érudition, prosternés sous l’autorité du maître Blanc. Sa langue, qui a servi à notre apprentissage et culture est nécessairement celle du savoir ; il ne faut pas y toucher. Sa technologie témoigne d’un savoir-faire probant, et sa rationalité épouse la science. Tandis que nos thèses à nous et nos sources, méconnues, sont, aux yeux des nôtres, forcément douteuses, à défaut de répondant ou de quitus du maître consentant. Sa reconnaissance est un sésame. Tant qu’il ne te l’a pas accordée, ta production, si brillante soit-elle, reste sans grande valeur, discutaillée par des ignorants, des présomptueux et des malhonnêtes qui dénient, et a trouvaille, suspecte.
Imaginez, dans ces conditions de mépris chez soi de nos facultés et de notre capital d’ingénierie intellectuelle, l’hostilité envers nos réalisations propres,« hors contrôle ». Nous avons essuyé le déni spéculatif de nos œuvres civilisationnelles dans le temps, et même la remise en question d’acquis de notre patrimoine historique, dédaignés par un maître manifestement mal intentionné. Il trouve néanmoins chez nous des disciples hypocrites, miséreux ; des gueux clamant des réserves infondées, semant le doute de complaisance, feignant la prudence, tandis qu’au fond, ils escomptent plutôt la faveur du mentor, à travers un suivisme intéressé.
Si nous sommes incapables de produire notre propre référence de la raison, inutile alors de parler de souveraineté. Ayant eu nos propres chartes de la cité, celle du Sosso précédant l’acte de Kurukanfuka 1236,du Mandé, lui-même contesté par les fidèles adeptes du gourou Blanc, quelle malédiction nous vaut de référer encore à la norme française, au moment où nous clamons nous défaire de tout asservissement ?
Les zélés élèves abreuvés au modèle français, avec son mythe de Révolution, ne peuvent que tenter de récuser, malgré les preuves de notre antériorité en la matière, la possibilité de synthèse d’une loi première africaine, différente de celles connues de leurs universités d’affiliation. Parce qu’ils ne savent pas réfléchir, et ne s’en donnent nullement la peine, ils sont prêts à dénigrer toute œuvre non conforme aux formules apprises dans la classe du maître, le propriétaire du standard d’un monde de progrès. Les fouilles et exhumations de ce qui traduit notre réalité leur paraissent une tentative désespérée de faire revivre le passé. Pour eux, nous devons nous contenter d’une adaptation à l’héritage colonial, en fait la déportation de notre âme.
Puisqu’ils ignorent l’essence de nos lois, bien qu’ils les vivent au quotidien, ne sachant faire le lien entre la valeur et l’énoncé de la norme, ils fétichisent le produit de leur initiation d’écoliers, et pensent qu’il s’agit uniquement d’adapter la règle et de se l’approprier. Ils n’ont guère conscience de reproduire ainsi, à contre-courant, le système colonial de l’assimilation. Mais, ces paresseux sociaux de la pensée, surpris par la révolution citoyenne, ne peuvent avouer leur dénuement intellectuel devant la convocation de l’histoire. N’étant que des élèves formatés, ils sont appelés à jouer le rôle de maître-assistant en environnement d’inculture, tandis qu’ils n’ont d’autres modes opératoires que la boîte à outils de la reproduction fidèle du modèle ingéré. Gonka !
Ce qui est dit, est dit
Nous avons besoin, et les ressources existent, de regénérer notre épine dorsale des lois, selon notre propre modèle d’État décentralisé, constitués de provinces fédérées. C’est grâce à cette architecture que nous avons su ériger des entités politiques de taille continentale et dont le rayonnement n’est, jusqu’à présent, pas évalué à sa juste dimension, faute de maîtres d’histoire de l’envergure du Pr Cheick Anta Diop. Pourquoi, malgré cette réalité historique indéniable, vous avez beau expliqué aux décideurs qu’on se trompe de copie de l’État, en maintenant le modèle accidentel de la domination étrangère, qui consacre son invalidité, des pseudo-experts et techniciens douteux s’accrochent à la réorganisation territoriale sur la base du découpage colonial, qui ne recoupe aucune réalité anthropologique, sociologique, ou humaine. Ce schéma fortuit de division, à but administratif, ne sert pas les intérêts d’une nation qui se reconstitue dans sa vérité. Faire du tracé de la stratégie de conquête coloniale, dont la justification a, avant tout, été militaire, la base de notre plan de reconstruction nationale, s’attribue moins à l’ignorance aujourd’hui qu’à une intention délibérée de nuire, à la limite de la trahison. Ce qui est dit, est dit. Ce message s’adresse à qui de droit. Je n’en dirais pas plus.
Il est opposable aux partisans du maintien, ou de l’alignement sur l’existant, les divergences de principe incontestables entre les sociétés africaines, d’une part, et les occidentales, de l’autre, pour se convaincre de la nécessité absolue de se libérer du joug aliénant du modèle. Fictions juridiques et prétentions démocratiques dans leurs projets servent à se leurrer et à abuser, et pas plus.
La sommation interpellative de l’intelligentsia
Avec des amis, nous avons mené une réflexion pour dire en quoi nos lois divergeaient par leur fondement de celle de nos oppresseurs. J’en donne ici quelques illustrations :
- Notre modèle de socialisation de l’enfant est en conflit avec le leur
- Leur construction de l’individu, détaché, s’oppose à notre vision de communauté solidaire
- Ils fonctionnent, eux, avec le sentiment de culpabilité, nous, avec le sentiment de honte
- Ils parlent d’égalité, là où nous invoquons plutôt l’équité
- L’homme et la femme sont égaux à leurs yeux, pour nous, ils sont complémentaires
- Leur unité sociale est la famille mononucléaire, chez nous, c’est la grande famille
- Leur notion de liberté individuelle heurte et met à mal notre conception de l’être redevable
- Ils mettent les droits en avant, nous nous mettons les devoirs en premiers
- Leur jeu du vote divise et alimente le conflit, le consensus allie et fortifie la communauté.
- La langue de partage étant la leur, les nôtres sont reléguées à un rang marginal.
Une Constitution est un miroir de l’âme du pays. On sent l’Allemagne dans la Constitution allemande ; la France, dans la sienne ; et la Chine, pareille. « Les fondations et la quintessence d’une nation se reflètent dans sa Constitution. Elle donne à un pays son caractère, le mode de fonctionnement de ses institutions, les aspirations, les références et les systèmes de valeurs de sa population ». Les nôtres, telles qu’elles se présentent, sentent le « cahier des doléances » des colonies. Nous nous appliquons, nous-mêmes, à tailler chez nous un État de domination à leur mesure et à leur service, et, nous, nous nous évertuons à rafistoler la camisole de force à coup de « ciseaux et de dentelles », pour en adapter la mensuration à nos infirmités. Kutubu !
Il doit être évident pour tous que la Constitution malienne, ressourcée, réappropriée, ne saurait encore être une pâle copie, un décalque, une retouche plus ou moins heureuse de la Constitution héritée du régime colonial et de ses suites, en flagrante contradiction avec nos propres normes de vie.

La dualité institutionnelle est un fait
Le dualisme institutionnel irréfragable oblige à une dualité formelle du système d’ordonnancement et de délibération ; un format de « Un pays, deux systèmes » que nous n’avons pu conceptualiser comme il faut. C’est bien pourquoi il est impérieux de travailler à bien définir les cadres, les espaces et les limites des régimes de droit applicables, intégrant les dimensions de la dualité institutionnelle et des territoires, pour constituer des districts judiciaires, urbains et ruraux, avec une organisation conforme, adaptée aux réalités culturelles des cibles.
La refondation nationale passe par un contrat social de rupture avec le système global de corruption qui a gangrené la république, marquée par les fléaux endémiques que sont : le caporalisme, la courtisanerie, le népotisme, le favoritisme, le clientélisme, le corporatisme et l’affairisme. Elle exige, pour tenir et faire face, une gouvernance légitime et vertueuse, basée sur des citoyens responsables, patriotes, avec un autre état d’esprit, notamment celui du sacrifice, au lieu du gain à tout prix. Il s’agit de briser les chaînes du mimétisme infertile et de l’imitation stérile, et faire l’effort de se reconstruire par nos valeurs qui germent à partir de nos racines. A cet effet, la Constitution tient plutôt à l’esprit de l’énoncé qu’à sa lettre.
Le MALIKURA n’est pas un autre Mali, c’est le même Mali appelé à se transformer pour devenir autre, une mue pour faire peau neuve, retrouver son âme, sa vertu et sa splendeur, redevenir le Mali des êtres dignes, honnêtes, intègres, responsables, courageux, croyants.
La souveraineté populaire n’est pas un slogan
La loi fondamentale en projet doit gagner le pari de la participation et de l’inclusivité, inspirée de nos valeurs sociales, culturelles, et aussi de la réalité territoriale, conformément aux aspirations du peuple qui devra se l’approprier. La souveraineté populaire ne doit pas être qu’un slogan dans le projet de refondation de l’Etat et de la Nation à reconstruire. Notre processus constituant transitionnel passe par de grands débats publics organisés sous forme de forums citoyens, avec la participation active des médias, afin de permettre au peuple entier de se l’approprier.
Mais, l’usage continu du français comme langue officielle a un côté handicapant indiscutable. Il exclue la majorité des citoyens. Ce qui équivaut à une duplicité de la classe dominante, héritière de l’État hybride postcolonial.
Remettre aujourd’hui l’officialisation de nos langues nationales aux calendes grecques traduit la même frilosité et indécision des sceptiques qui s’étaient prononcés contre l’accession à l’Indépendance, en 1960, prétextant que soient réunis d’abord les « conditions » pour y aller. Ridicule ! Nous devons impérativement revenir à l’intelligence de nos sources par l’habilitation conséquente de nos langues. L’officialisation systématique de toutes nos langues nationales est à notre portée, avec l’adoption conséquente d’une loi sur leurs statuts et emplois. Question d’intelligence et de savoir-faire.
Les structures, à l’image des hommes
Allons déjà à l’introduction dans la nouvelle Constitution d’une nouvelle sémantique institutionnelle adaptée, valorisant des concepts idiomatiques réappropriés, pour en tirer une nomenclature juridique malienne et africaine ressourcée, qui emprunte à la richesse de nos langues nationales, toutes mises à contribution, pour refléter l’identité commune. Le Burkina l’a expérimenté. Il est proposé de donner des noms tirés de nos langues à différentes catégories de termes juridiques. Une recherche lexicographique dans les 13 langues nationales permettra de retenir à chaque fois l’appellation qui, en plus d’une réelle valeur symbolique et de la résonance, a du sens auprès du grand public. Des arguments spécieux, on en trouvera toujours. C’est Marcus Garvey qui disait : « Dans la lutte pour s’élever, les opprimés sont toujours handicapés par ceux d’entre eux qui trahissent leur propre race, c’est-à-dire par les hommes de peu de foi, et tous ceux qui se laissent corrompre et acceptent de vendre les droits de leurs propres frères. Chez les autres races, le rôle du traitre se limite en général à l’individu médiocre et irresponsable. Les traîtres de la race noire, malheureusement, sont la plupart du temps, des gens haut placés par l’instruction et la position sociale, ceux-là même qui s’arrogent le titre de leaders ».
A chacun de faire son examen de conscience. La citation renvoie à la personne des « malhonnêtes », la mauvaise graine, indexés dans mon précédent article. Les traîtres sont parmi nous. L’homme malien étant l’artisan de la mutation de conscience attendue, il est impératif de ramener chacun à l’intelligence de soi, « se connaître soi-même ». D’où la nécessité impérieuse du ressourcement, à travers nos savoirs endogènes, marginalisés ou dédaignés, et, le plus souvent, outrageusement ignorés.
C’est dire que notre ingénierie institutionnelle doit prendre les briques de nos valeurs fondatrices pour rompre avec l’asservissement mental, en vue de nous reconstruire. Parmi ces valeurs premières, il y a la grande famille dans le lien du sang et des alliances ; le jeu de la hiérarchisation sociale, de l’humilité et de la coopération ludique des rivaux ; le dialogue de raison doublé du consensus ; l’équité et le devoir universel de solidarité ; la garde de la vertu et de la mémoire. Ces valeurs fondent notre Maaya.
La sagesse qu’il convient de retenir, un enseignement des sciences sociales, c’est que « Ce ne sont pas aux hommes de se faire à l’image des structures, mais ce sont les structures qu’il faut concevoir plutôt à l’image des hommes ». Espérons que le Constituant saura en tirer les leçons.
ANW KA MALI. Nous y veillons.
Mohamed Salikènè Coulibaly
Ingénieur
05 février 2023