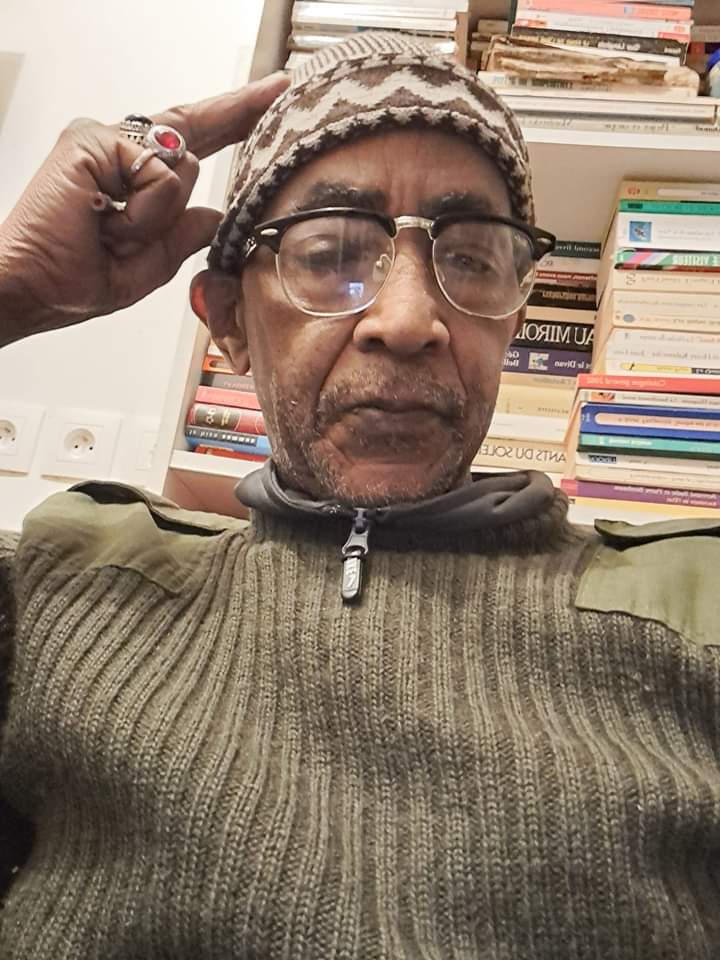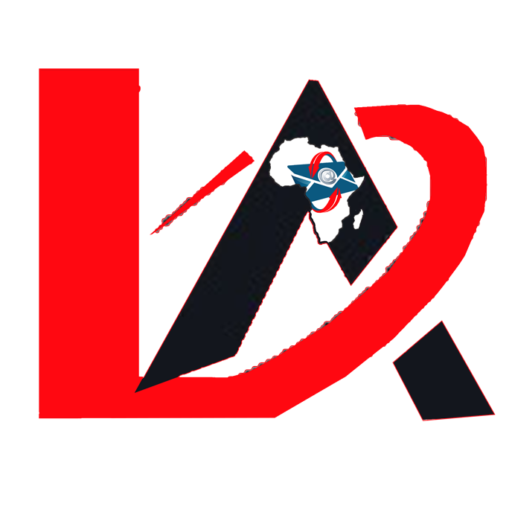Le Mali constitue une exception en Afrique sur le plan culturel et sur la construction des institutions politiques. De façon incontestable la nation malienne a précédé l’état colonial importé.
Historiquement le Mali constitue le berceau de toute l’Afrique de l’Ouest qu’il a dominé au moins plus d’un millénaire. L’origine des peuples du Mali actuel se situe dans l’empire Soninké.
L’empire de Ouagadou ou Ghana a constitué un creuset de rencontres, de brassages de différents peuples venus de différents horizons.
« Le Ghana était situé au Nord des deux boucles divergentes du Sénégal et du Niger. Il comportait essentiellement l’Aouker au Nord et le Hodh au Sud. Ce pays était appelé souvent le Ouagadou (pays des troupeaux). En effet, le Sahel soudanais bénéficiait alors climat humide qui favorisait l’élevage et même l’agriculture. Par ailleurs, sa situation au contact des deux zones, saharienne (donc maghrébine) et soudanaise, aux productions variées sinon complémentaires, destinait naturellement cette région à une fructueuse fonction commerciale. Or donc, vers le IXème siècle ap. J.-C., vivaient dans le Hodh et l’Aouker conjointement des pasteurs d’origine berbère (Sanhadja notamment) et des cultivateurs sédentaires noirs, sans compter les multiples groupes métissés. L’élément dominant était constitué par les Ba Four (bambara ou Mandé, Toucouleur, Wolof et Sérèr) sans oublier les Songhaï à l’Est. Tous ces groupes ethniques vivaient donc à l’époque, beaucoup plus au Nord qu’aujourd’hui comme en font foi leurs propres traditions d’origine et les analogies frappantes entre leurs ustensiles et les restes de poteries retrouvés dans l’Aouker et le Tagant. Les Soninké en particulier, dont les descendants forment les groupes Sarakholé, Marka, Dioula, Dafing, etc. doivent être considérés comme les vrais fondateurs de l’empire du Ghana » (Joseph Ki-Zerbo – Histoire de l’Afrique Noire – édition Hatier – paris 1978)
C’est fait unique dans l’histoire de rencontres et de mélanges entre de différents peuples de différentes couleurs qui va donner au Mali actuel une véritable richesse culturelle, une culture complète issue de la puissance de l’empire Soninké et des différents empires qui vont lui succéder et va constituer une source de sentiment de fierté, de grandeur et de dignité pour les maliens d’aujourd’hui. – sentiment légitime ou pas – les faits historiques sont là, indiscutables.
De cette terre du Soudan Occidental, le Bir-Es-Soudan, le pays des Noirs va constituer cette terre qui à travers la succession des trois grands empires organisés en états naîtront des héros civilisateurs, bâtisseurs d’institutions politiques, de constitutions solides qui vont traverser les vicissitudes de l’histoire dont les lumières vont nous parvenir jusqu’au 21ème siècle. L’exemple de la charte de Kouroukan Fouga en est une illustration éloquente. La Chatre de Kouroukan Fouga est devenue un patrimoine
immatériel de l’UNESCO en 2006. Cette Charte est considérée comme la première déclaration de droits de l’homme au monde.
Soundiata Keïta est l’auteur et le fondateur de l’empire du Mali au 13ème siècle. Soundiata Keïta est d’abord un chasseur accompli – Simbo – formé dans la confrérie de chasseurs guerriers du Mandé. La Charte proclamée à Kouroukan Fouga est d’abord la Charte des chasseurs du Mandé avant de devenir la constitution de toute l’Afrique de l’Ouest. C’est une vision, une pensée politique, une idéologie qui fonde une unité, une cohésion des peuples de toute l’Afrique de l’Ouest.
C’est à juste titre que Soundiata sera considéré comme le fondateur de l’esprit d’un peuple et d’une nation, c’est pour cela qu’il est encore chanté en 2023 comme l’incarnation de son unité.
Kankou Moussa fera connaître le Mali au 14ème siècle au monde Arabe et Européen à partir de son fastidieux pèlerinage à la Mecque. Il est celui qui va fonder, les premiers fondements de « l’Islam noir » en Afrique de l’Ouest. Il est considéré aujourd’hui comme l’homme le plus riche de l’histoire humaine.
Au 15ème siècle Soni Aliber, le farouche guerrier païen va fonder l’empire Songhaï qui va étendre les frontières de l’ancien Mali dont il est héritier.
Fin 16ème siècle naîtront deux royaumes par le fait de deux hommes d’exceptions, le royaume Bambara de Ségou et le royaume Peulh du Massina. Deux royaumes jumeaux vont partager un même espace avec des visions et des doctrines complètement opposées. Le royaume de Ségou dont le fondateur Biton Mamari Coulibaly est le chef d’une confrérie de chasseurs Bambara, tandis qu’Ahmadou Sekou avait une vision, une doctrine politique fondée sur le Coran et la Charia. C’est deux royaumes constituent un symbole de coexistence pacifique.
Face à la pénétration coloniale des hommes vont se révéler et se hisser à la hauteur de l’histoire en renouvelant l’esprit d’une civilisation fondée sur la bravoure, la dignité, la défense résolue de la terre des ancêtres. Ceux qu’on appelle aujourd’hui patriotes et nationalistes. Il s’agit de :
El-hadj Oumar Tall le prophète Poular qui après avoir écrit sa doctrine philosophique, politique religieuse, dans l’ouvrage Arimah (le livre des lances), et sous l’injonction de Allah va déclencher le Djihad face à l’envahisseur en attaquant le fort français de Madina Saro défendu par le métisse capitaine Toll le 13 mars 1857. Il se révéla ensuite comme un conquérant d’exception qui va fonder sa domination sur un million de kilomètres en 10 ans. Il est le fondateur de l’une des confréries religieuses contemporaines puissante et influente à travers toute l’Afrique de l’Ouest.
Samory Touré surnommé le napoléon noir fut un chef de guerre issu d’une société qu’il n’a pas détruit et qu’il va soigner de sa sclérose pour faire face à l’invasion coloniale. Samory n’écrira pas de doctrince politique, mais il va cependant incarner les vertus les plus élevées de son peuple pour en devenir le conducteur. Il sera le résistant le plus farouche, le plus déterminé et plus irréductible à la pénétration coloniale. Ce qui qui fera du peuple mandé du 21ème siècle le plus conscient et le farouche défenseur de son identité culturelle au 21ème siècle.
Babemba Traoré, roi de Sikasso se donnera la mort le 1 mai 1898 plutôt que de se rendre au colon français.
Malmine Dramé, Marabout guerrier Soninké opposa des batailles sanglantes face à la pénétration coloniale, il ne s’est rendu que mort au colonel Galiéni.
Malgré la violence et les destructions du fait des colons, malgré l’infériorité militaire des hommes soudés à leurs peuples offrirent leurs poitrines à l’envahisseur pour défendre cette soif sans fin de liberté, de dignité et de souveraineté. C’est ce sentiment qui va se manifester dans la révolte des Bambaras du Bélédougou, des Bobos de Banani, des Touarègues de Firoune et Kaouzen.
A l’indépendance Modibo Keïta, le premier Président de la République du Mali va incarner les vertus les plus élevés et l’esprit de civilisation hérité de la culture des hommes qui ont bâti des empires et des royaumes à travers l’histoire de l’Afrique de l’Ouest. Modibo Keïta étoile filante, archange flamboyant au seuil du nouveau monde, il va imposer au reste du monde la vision d’un Mali libre et souverain à partir d’une diplomatie vigoureuse et cohérente. La mémoire de l’ONU se souvient encore du discours de son ministre des affaires étrangères Seydou Badian Kouyaté en 1965 intitulé : « Uthan à raison ». Discours qui a failli faire démissionner le Secrétaire Général de l’ONU de l’époque.
C’est tous ces mélanges de faits historiques, de mythes, de légendes, de larmes, de sang, de victoires et d’humiliations qui constituent : L’Âme du peule malien. Elle est immatérielle, invisible. Mais elle est vécue, chantée, magnifiée, conscientisée, elle constitue le moteur de l’action du peuple malien d’hier à aujourd’hui.
Dispersé ou réduit à l’exil intérieur, c’est cette âme que le peuple malien persiste à entretenir à partir de ses manifestations culturelles. Peuple éternellement révolté face à l’injustice et à la domination, le reste du monde reste fasciné par sa bravoure suicidaire. Peuple digne et fière, il a su prouver à tous les tournants de son histoire qu’il a du ressort pour rebondir, ressaisir son destin pour faire face aux épreuves du présent ; parce qu’il a ce sentiment viscérale, quasi mystique d’être un peuple originel, unique, soudé, uni dans des liens inextricables depuis la nuit des temps.
Confronté depuis plus d’une décennie à une crise profonde et multidimensionnelle le monde s’interroge : Comment sortir ce pays de ce Chao généralisé ? Pas de panique.
ORDRE ET DESORDRE : La rupture et / ou la continuité
« Toutes les sociétés sont confrontées au désordre, leur ordre en est indissociable. Celles que la tradition gouverne encore se définissent elles-mêmes en termes d’équilibre, de conformité, de stabilité relative ; elles se voient comme un monde à l’endroit où le désordre peut avoir des reflets négatifs et mettre toute chose à l’envers. On tente de faire de l’ordre avec du désordre, de même que le sacrifice fait de la vie avec de la mort, de la loi avec de la violence domestiquée par l’opération symbolique. Puisqu’il est irréductible, inévitable et nécessaire, la seule issue est de l’utiliser à sa
propre et partielle neutralisation et de le convertir en facteur de l’ordre. Il devient ainsi l’instrument d’un travail positif.
La modernité, c’est le mouvement plus l’incertitude ; elle avive la conscience de désordre. Le recours à l’explication par le désordre manifeste la réalité présente en certains de ses états : il révèle la quasi impossibilité de la comprendre autrement, il révèle de la logique constitutive des mythes contemporains. Une exploration interprétative, sociologie et anthropologique permet d’identifier des figures actuelles du désordre – l’événement brutal, l’épidémie et le mal, la violence et le terrorisme, le politique déforcé – et des formes de réaction à l’irruption du désordre – la réponse totale ou totalitaire, la réponse de la personne par le sacré, la réponse des pragmatiques par le mouvement » (Georges Balandier – Les désordre – édition Fayard
– 1988)
LA LONGUE HISTOIRE DE PEUPLE DE MARCHEURS : Le Festival international Soninké (FISO) ou la renaissance de l’identité culturelle Soninké :
L’origine des Soninkés se situe dans l’empire de Ouagadou, appelé Ghana par les chroniqueurs Arabes. Les Sonikés sont les bâtisseurs de cet empire, première organisation étatique de l’Afrique noire connue de l’histoire écrite et de la tradition orale.
Les récits historiques placent la naissance de l’empire Soninké du Ghana au IVème siècle après J-C. Incontestablement les Soninkés ont hérité et bénéficié de connaissances et de techniques de provenances très diverses. Les tribus Soninkés du Bakounou, de Ouagadou et de tout l’Aouker purent dès lors s’organiser rn royaume au 1er siècle de l’Ère chrétienne en absorbant les populations qui n’avaient pas dépassé le stade tribus.
Le développement atteint par l’empire au VIIème siècle au moment où il entra en contact avec les propagateurs de l’Islam, suppose une longue période de formation, puis de maturation d’institutions, de coutumes, de techniques et règles de vie que la nouvelle religion ne réussira pas à ébranler.
L’empire atteint son apogée au Xème siècle sous la dynastie des Kaya Maghan. Il s’effondre au Xième siècle en 1076 sous les coups de boutoirs des djihadistes Almouravides. Ainsi commença le déclin de l’empire.
Le vaste empire englobait : une partie du Sénégal, du Niger, de la Mauritanie, du Mali, de la Gambie, sud du Sahara, de la Guinée Bissau et de l’actuelle Guinée Conakry.
Les fouilles effectuées à Kumbi Saleh, l’ancienne capitale de l’empire Soninké, située dans le sud-Est mauritanien montre à suffisance la richesse, la splendeur culturelle et la grandeur de cet empire administrativement et militairement bien organisé.
Avant sa disparition l’empire Soninké avait achevé de construire le sous-bassement culturel, politique, juridique et institutionnel des organisations socio-économiques, des royaumes, des empires qui vont se succéder dans l’espace du Soudan occidental jusqu’au XVIème siècle.
Tombouctou au XVIème siècle reflètera toute la magnificence de cette culture qui a su allier la spiritualité et la prospérité matérielle. Son université Sankoré qui recevait plus de 25 000 étudiants pour 15 000 habitants, était animée essentiellement par des érudits Soninkés, dont le plus connu était Mahmoud Bakayogo, le maître et formateur d’Ahmed Baba. La langue usitée dans la cour impériale de Gao était le Soninké.
Grands voyageurs devant l’éternel, commerçants et érudits dans l’âme les Soninkés vont propager leur culture à travers tout le Soudan occidental et vont influencer toutes les contrées visitées. La saga Samorienne avant d’être un mouvement de reformes des institutions sociales, économiques et politiques de l’Afrique de l’Ouest, trouve son origine dans la révolution Dyoula autrement dit Soninké au XVIIIIème siècle.
Aujourd’hui les Soninkés forment de vastes communautés partout dans le monde. En Europe, notamment en France, aux USA, au Proche-Orient, au Moyen-Orient et en Asie.
Les caractéristiques principales de la culture Soninké qui ressortent de son expérience multimillénaire et multiséculaire, ce sont l’attachement des Soninkés à leur culture d’origine, à leurs terroirs avec des valeurs essentielles comme le travail laborieux, l’entraide mutuelle, la solidarité, le sens de la justice et de l’équité, la recherche permanente du consensus en vue d’une société stable gage de paix et de prospérité.
Ces diverses caractéristiques ont permis aux Soninkés à travers leur dispersion dans le monde entier de mettre en œuvre de vastes réseaux d’activités leur permettant de maintenir leur vitalité culturelle avec cette capacité de lier le culturel à l’économique, l’ouverture et l’adaptation aux autres cultures. Ces caractéristiques fondées sur les tissages de liens et de ponts entre les différentes cultures, entre les différents pays a permis au peuple Soninké d’inventer un modèle unique et efficace du vivre-ensemble et d’intégration dans le pays d’accueil.
Pour cette culture, si l’individu existe le groupe social aussi existe. Il s’agit de trouver les points de leur complémentarité pour les intérêts de tous.
Nous voilà encore réunis après 942 ans de dispersion, nous sommes là, vivants, présents, après de longues années de pérégrination à travers le monde. Le festival international Soninké s’est aujourd’hui institutionnalisé, pérennisé comme un lieu de communion à travers les valeurs cardinales de la société Soninké alliées à ce qui se fait de mieux dans le monde. Le festival est à la fois culturel et scientifique.
L’idée de festival est née en visant l’objectif suprême de la renaissance de l’identité culturelle Soninké dans le monde actuel.
Le festival dès sa première édition en 2011 à Kayes a fait se rencontrer pendant 5 jours des scientifiques de renoms dans leurs spécialités, des historiens émérites, des érudits de la culture orale Soninké, des linguistes et des économistes confirmés pour évoquer des thèmes relatifs à la codification de la langue et de la culture Soninké, aux mutations socio-économiques interpellant l’identité Soninké, aux enjeux de l’immigration, et de la place de la femme dans la société actuelle.
Aujourd’hui jour d’ouverture de la 5ème édition du festival international Soninké de Dakar, nous pouvons dire que nous avons atteint certains de nos objectifs à savoir : le FISO s’inscrit désormais dans le paysage socio-culturel et économique des Soninkés tout en servant comme outil efficace d’intégration sous-régional.
Le FISO est devenu le lieu d’échanges et de création où se retrouvent des paysans, des commerçants, des chercheurs, des artisans, des artistes et des citoyens du monde entier. Il constitue aujourd’hui un lieu d’incubation de l’avenir.
Aujourd’hui nous savons que nous avons fait le bon choix de commencer par la culture pour reconstruire notre unité, de nous appuyer sur ce levier primordial. La culture est au commencement et à la fin de la destinée humaine et des sociétés humaines. Elle constitue le seul rempart contre la violence, la barbarie, le désordre. La culture a la fonction suprême de réguler le chaos.
Chemin faisant, nous avons compris que face au chaos de la globalisation actuelle, et de la contestation de l’ordre ancien et des valeurs anciennes, entre le « traditionnel » gage de stabilité et le « moderne » synonyme de changements permanents, il ne saurait y avoir de barrières étanches, d’oppositions figées, mais mouvantes, et que les frontières entre l’une et l’autre servent à chaque époque à redessiner, à redéfinir à nouveaux frais de nouveaux projets que la société se donne de façon collective.
C’est à partir de leur confrontation que l’on peut juger du degré de maturité et d’adaptabilité d’une culture donnée.
Chemin faisant, nous avons mieux affiné et mieux adapté notre conception du développement à la réalité.
Nous avons retenu que : « le développement est un processus global d’amélioration des conditions de vie de toute une communauté sur le plan économique, social, culturel et politique. Pour être durable, le développement doit se montrer tout à la fois économiquement efficace, écologiquement durable, géopolitiquement acceptable, culturellement diversifié ».
L’analyse du processus fait apparaître un facteur déterminant définissant la particularité du processus en même temps que les caractéristiques de la société dans laquelle le processus se déroule. Il s’agit de la dimension culturelle. Cette dimension centrale ne peut être ni un handicap ni une contrainte, la culture n’étant jamais quelque chose de figée, elle évolue ou disparaît au rythme des interactions qui ne cessent de se produire.
Aussi, on peut retenir que la spécificité culturelle, l’identité culturelle globale d’un peuple d’une nation, cette architecture de réponses constitue le ressort ultime de son évolution de son « développement »
Cependant le levier culturel ne saurait suffire, car chaque société pour atteindre son niveau optimum de développement est obligée de bâtir avant son unité, sa cohésion pour prendre et marquer sa place dans le monde. Comprendre la spécificité culturelle, c’est comprendre la place et la fonction de l’identité culturelle.
Le fait de culture se manifeste comme un aimant, un outil, une identité, un sous- bassement, vouloir nier ou détruire au niveau d’un groupe d’individu ce soutien existentiel serait criminel, contre-nature, un véritable ethnocide.
Ce soutien est en effet vital car il procède de toute une dynamique historique propre qui donne une substance, un suc à la vie de l’être humain et du groupe que ni l’économie ni la politique ne peuvent lui apporter.
La dimension culturelle est un instrument dont on ne peut pas se passer ce n’est ni un bien, ni un mal. Il est de la responsabilité de chaque groupe humain de visiter de façon permanente cette dimension pour « nettoyer » ses composants les plus archaïques et les plus vétustes afin de lui donner un souffle nouveau, un sang nouveau pour qu’elle retrouve son rythme propre et son adaptabilité au monde, au présent.
Cette définition comprend la culture dans son acceptation la plus large comme un esprit de civilisation, c’est-à-dire une vision commune du monde, une manière de penser, de vivre et d’agir qui caractérise un groupe, un peuple, une nation. Système de références, religieuses, esthétiques, artistiques, éthiques, intellectuelles qui permet à un groupe d’aborder le monde sans dissoudre et disparaître.
Cet esprit s’appelle « Dinguira » chez les Soninkés. Pour cet esprit, la diversité est la condition même de l’unité dans l’esprit commun de solidarité avec un seul objectif, une seule direction. C’est surtout un outil de gouvernance organique, inclusif, total, qui ne laisse personne dans la marge. Ainsi la culture pour un peuple est comparable à ce qu’est une personnalité pour un individu. Un groupe ayant une personnalité arrive à se situer face aux autres, il marque sa place, possède face au monde une opacité et une épaisseur. En l’absence de cette dimension il perd son autonomie de mouvement et de décision. Il se dilue et disparaît, écrasé ou absorbé par des cultures plus fortes et plus dynamiques. La culture confère ainsi une force, un axe, une identité.
Dans ce sens lorsqu’une culture commune est partagée par un grand nombre, si elle est dynamique et cohérente à la fois vécue et conscientisée peut représenter un champs de densité dans un rapport de force économique et politique. C’est dans ce fait immatériel que s’enracine le groupe Soninké à travers le monde, des hommes reliés à une terre-mère et unis dans un même fil dont chaque individu est une graine, une perle.
La globalisation mondiale des échanges contraint singulièrement la liberté de choix que pourrait faire différents acteurs, différents pays en ce qui concerne leurs modes de développement qui leur seraient propre.
L’intégration au système concurrentiel est la voie de passage pour chaque pays, chaque groupe social sous peine de marginalisation et d’exclusion.
Les pays Africains dans leur majorité ont besoin de réformes profondes, de changements économiques, sociaux, surtout de modes de gouvernance et de culture politique. Les pays ont ainsi de nombreux défis à relever. Cependant il est de leurs responsabilités politiques et historiques d’analyser, de comprendre et de mettre les solutions les plus efficaces pour eux. Personne ne fera ce travail à leur place, celui de l’invention d’un modèle.
Seront-t-ils capables de répondre à ces défis ? D’autres cultures et d’autres civilisations ont pu répondre pour exister au monde et triompher au XXIème siècle. Pourquoi pas l’Afrique ?
Les Africains doivent surtout savoir qu’il n’y a pas de miracles en ce qui concerne l’évolution historique, politique sociale et économique. Nous savons que l’Europe a mis 1 000 ans de Moyen-Age pour renouer avec les créations les plus brillantes de son histoire et engager ainsi sa renaissance.
Faut-t-il le rappeler ? l’Asie s’est sortie de la grande misère par la sueur et l’inspiration, à partir de la lumière qu’elle a pu trouver dans les tréfonds de sa civilisation plusieurs fois millénaire. L’Asie a su ainsi s’ouvrir au monde sans détruire les valeurs profondes de sa civilisation. Nous avons là des modèles de civilisations authentiques, originaux, adaptés à leurs trajectoires historiques. Ces modèles peuvent servir d’exemple montrer la voie à emprunter pour renaître, il n’en demeure pas moins qu’ils restent des modèles que l’on ne peut pas importer et appliquer à l’Afrique les yeux fermés parce qu’ils ont marché ailleurs.
Les différentes civilisations n’ont pas les mêmes trajectoires, n’ont pas les mêmes bases culturelles aussi leurs réflexes d’adaptations au monde ne peut être que différents.
Aujourd’hui un certain nombre de penseurs trouvent que le XXIème siècle sera le siècle de l’Afrique à cause de ses atouts et de ses potentialités, à cause de la résilience des peuples Africains car ils ont prouvé par le passé qu’ils étaient capables malgré les terribles chocs subits dans leur histoire de se relever, renaître et s’affirmer face au reste du monde.
Mr Daffé Seydou, Mr CHAM Alhasana consultants