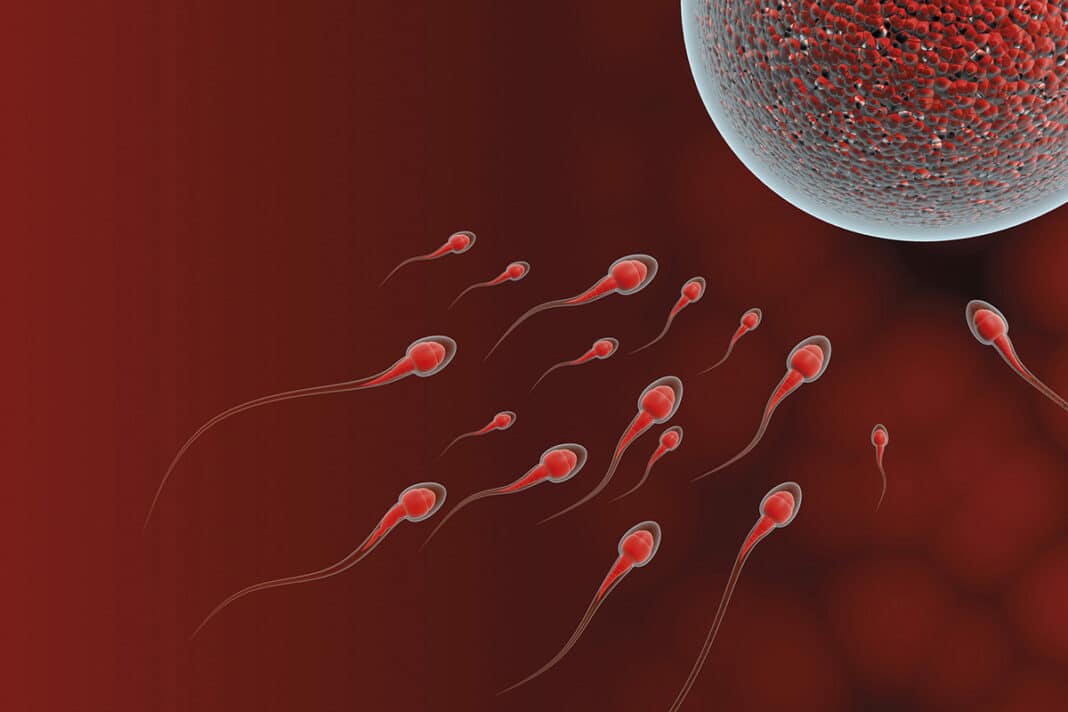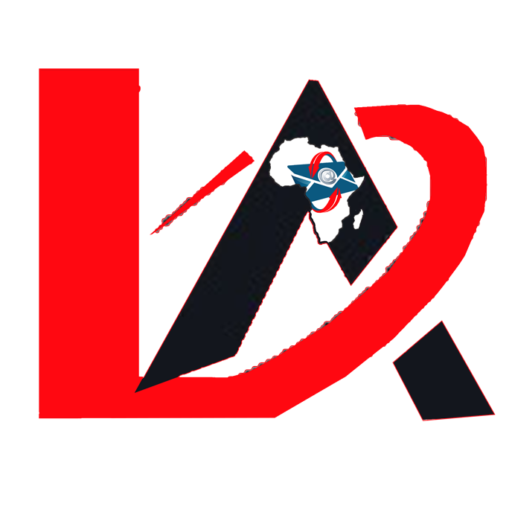Dans un monde où la vérité vacille, où la liberté recule sous le poids du silence, il est des voix qui refusent de se taire. Parmi ces voix, celle d’un homme, d’un journaliste, d’un veilleur de l’humanité. : Monsieur Amadou Diallo dit N’Fa (Bamako).
Héritier des voix anciennes, tu n’es pas seul lorsque tu parles. Derrière ta plume, il y a des siècles de sagesse. La voix de ton père, homme digne et silencieux, engagé sans compromis. Celle de ta mère, gardienne de l’amour discret mais fort, transmettant la force intérieure. Et plus loin encore, les voix de tes ancêtres africains, porteurs de paroles vraies, de traditions orales, de contes et de vérités profondes. Fils du Mali, voix de justice, tu viens de cette terre rouge et fière : le Mali, berceau d’empires, de rois justes, d’orateurs, de bâtisseurs. De Tombouctou à Bamako, la terre malienne est mémoire et dignité. Et toi, tu en es l’écho vivant. En artisan de la vérité, tu n’as pas choisi la facilité. Là où d’autres ferment les yeux, tu ouvres les tiens. Ton métier n’est pas une fonction, mais un engagement. Tu écris non pour faire du bruit, mais pour faire sens. Le journalisme que tu incarnes est un flambeau, porteur de valeurs, Et tu le portes haut, au service de ceux qu’on n’écoute pas. Avant tout, tu es un fils, un homme debout : fruit d’une éducation enracinée dans les valeurs ancestrales, où le respect de la parole donnée, le sens du devoir, l’amour du savoir, la solidarité, la vérité ne sont pas de vains mots. Défendre la justice, c’est honorer les ancêtres. C’est marcher à leur suite, tête haute, avec le cœur en éveil. Tu n’informes pas, par ta plume, tu éduques. Chaque mot est une graine : de conscience, d’espoir, de résistance. Tu rappelles que le journalisme peut être un acte d’amour : amour du peuple, amour de la vérité, amour d’un avenir plus juste.
Un message pour les générations
Ce texte est aussi une transmission, une lampe tendue à nos enfants, à nos familles : Il est encore possible de rester debout dans l’honneur. Il est encore noble de défendre les plus faibles. Et il est essentiel de ne jamais se résigner. Nous devons être les passeurs des valeurs reçues. Et toi, cher Monsieur Diallo, tu en es le témoignage vivant. Merci pour ton courage, ta constance, ta voix claire dans le tumulte. Tu fais honneur à ton métier, à tes ancêtres, à ton pays, et à ta condition d’homme libre et digne.
Le travail est la première richesse de l’homme libre.
C’est par ses mains, par son courage et sa persévérance que l’Africain façonne son avenir, non pas en copiant des modèles extérieurs, mais en s’appuyant sur ses propres valeurs, ses ressources humaines et son patrimoine vivant. Des solutions africaines pour un avenir africain. L’Afrique n’est pas en quête de sauveurs. Elle est en quête de solutions africaines. Des solutions ancrées dans la réalité, dans la terre, dans la parole, dans l’écoute. C’est là que réside la force de la communication : un pont entre les générations, un outil de transmission, d’éducation, de formation et d’orientation.
L’éducation au cœur des communautés
Dans nos villages comme dans nos villes, l’éducation ne commence pas à l’école. Elle commence dans la cour familiale, autour du feu, à travers les contes, les proverbes, les silences lourds de sens. L’enseignement africain est enraciné dans le vécu, l’observation, le respect des anciens. Il prépare à affronter la modernité sans oublier qui nous sommes.
Le journaliste, gardien de la mémoire
Au cœur de cette transmission, le journaliste a un rôle sacré. Il n’est pas seulement un relai d’informations, mais : la mémoire vivante du peuple, la voix des sans voix, l’oreille des douleurs tues, le miroir des espoirs brisés ou en gestation. Un journaliste africain écoute pour comprendre, parle pour relier, montre pour éveiller.

Bâtir l’avenir avec vérité et enracinement
Aujourd’hui plus que jamais, le Mali et l’Afrique ont besoin de journalistes :
Bâtisseurs
Formateurs
Porteurs de vérité
Enracinés dans les réalités locales
Tournés vers un avenir commun
Travail, dignité, parole vraie et transmission du savoir : ce sont là les clés de notre renaissance. L’Afrique ne se sauvera pas par l’imitation, mais par l’élévation. Une élévation fondée sur la valeur humaine, le patrimoine culturel, et la puissance d’une communication éthique, vraie, et au service du peuple. Monsieur Diallo et moi, partageons des valeurs communes : celles de la civilisation peule du cosmos.
Ô Peul, ô multitude qui s’étend de Conakry à Bamako, du Sahel poussiéreux aux rives verdoyantes de la Casamance, toi qui portes dans ta mémoire la poussière des savanes et la sève des forêts, tu n’es point un spectateur muet du monde, mais son horloge vivante, son pouls, son souffle. La civilisation, en toi, n’est pas seulement une histoire écrite par des mains humaines, mais une alliance avec la nature, une reconnaissance du cosmos, un chant d’étoiles qui parle aux racines profondes des arbres comme aux sources souterraines des rivières. Les ancêtres de Guinée, du Mali, du Tchad, du Burkina, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Niger, de l’Éthiopie – tous savaient que la cosmogonie peule n’est point une fable : c’est l’architecture secrète de l’univers, la géométrie des étoiles, la danse des fleuves et de la faune, la sagesse des montagnes, le silence fertile des minéraux. Ils savaient que l’animal est frère, que le baobab est maître, que les pierres parlent, que les rivières chantent, que les lacs et les océans gardent mémoire des premiers temps. Et parmi ces peuples, les Peuls- gardiens des troupeaux, pèlerins du vent et de la steppe- ont transmis une connaissance subtile : ils enseignent que l’homme est un berger dans l’univers, responsable non seulement des animaux mais aussi des équilibres invisibles. Leur sagesse murmure que la vache n’est pas richesse seulement, mais souffle, mémoire et lien entre l’homme, la terre et le ciel. Ils savent que chaque pas de l’animal inscrit une prière dans la poussière, que chaque étoile au-dessus des pâturages est un mot du grand livre du cosmos. Car l’homme, fût-il roi ou esclave, marchand ou mendiant, n’est jamais qu’un fragment de ce grand tissu, une fibre dans le drap sacré où l’arbre, l’animal, le vent et le feu sont les compagnons de route. L’éléphant qui avance, le lion qui guette, le poisson qui glisse dans les profondeurs, l’oiseau qui fend le ciel- tous sont les pages d’un livre plus ancien que les royaumes. Mais hélas ! Voici que les empires modernes, aveugles de métal et d’orgueil, veulent rompre ce pacte. Ils proclament progrès ce qui n’est que dévastation, civilité ce qui n’est qu’appauvrissement, commerce ce qui n’est qu’asservissement. Ils arrachent les forêts, empoisonnent les fleuves, étranglent la terre et nomment cela richesse. Et le peuple, noble peuple, ploie sous des promesses creuses : l’école qui oublie la sagesse des anciens, la politique qui se vend comme marchandise, la religion travestie en instrument de pouvoir. Alors que jadis, les poètes et les sages parlaient au ciel comme à un frère, aujourd’hui le tyran parle au peuple comme à une chose. Mais que l’on ne s’y trompe point ! La forêt connaît la patience, la savane connaît la renaissance. Le lion sommeille, mais son rugissement n’est pas mort. Le fleuve garde mémoire des pluies, les pierres n’oublient jamais le pas des ancêtres. Les pasteurs peuls, gardiens des voies du vent, rappellent encore que l’homme doit marcher léger dans l’univers, car il n’est qu’hôte sur cette terre. Un jour, le peuple redeviendra cosmos. Le citoyen redeviendra fleuve. L’enfant redeviendra héritier du ciel. Alors, sous la vaste voûte étoilée, les hommes riront enfin des rois menteurs, et le théâtre du monde retrouvera sa tragédie sublime, où chaque être, animal ou arbre, pierre ou étoile, homme ou souffle, reprendra sa juste place.
Le Journaliste, flambeau de la vérité
Être journaliste n’est pas un métier facile. C’est une vocation ardente, un combat permanent au cœur des turbulences économiques, des tempêtes politiques, des fractures sociales. C’est un chemin semé d’épreuves, mais aussi de grandeur. Car le journaliste est bien plus qu’un observateur : il est acteur de la mémoire collective, veilleur de la conscience humaine, éveilleur de l’avenir. Au carrefour du progrès. Le journalisme se dresse là où se croisent l’économie, l’éducation, la formation et la politique. Il est ce carrefour du progrès, cette intersection où l’avenir d’un peuple se dessine par la parole, par l’écrit, par l’image. Le journaliste n’est pas un simple témoin, il est un médiateur : entre le savoir et l’ignorance, entre le pouvoir et le peuple, entre le présent brûlant et l’avenir en gestation. Il éclaire pour que la jeunesse marche dans la dignité. Aujourd’hui, le métier se confronte à des forces nouvelles : le numérique qui transforme la vitesse de l’information. L’intelligence artificielle qui interroge la vérité et l’éthique. L’industrie mondiale et les marchés internationaux qui dictent leurs lois d’airain. Face à ces défis, le journaliste demeure le gardien du sens. Car au-delà des machines, au-delà des algorithmes, il reste ce que jamais aucune technologie ne pourra remplacer : une conscience humaine, une sensibilité, une responsabilité.
Dans un monde où les écrans éblouissent mais n’éclairent pas toujours, le journaliste aide le peuple à comprendre. À déchiffrer les enjeux de l’économie. À mesurer le poids du pouvoir. À discerner les voies de l’avenir. Il ne nourrit pas seulement l’opinion : il élève les consciences, il fortifie les âmes, il rend à la jeunesse le droit d’avancer la tête haute.
Un métier sublime et tragique
Sublime parce qu’il touche à l’essentiel : la vérité, la justice, la dignité. Tragique, parce qu’il s’exerce souvent dans l’hostilité : hostilité des puissants, hostilité du mensonge, hostilité du silence. Ainsi est le journaliste : un homme ou une femme debout, une voix qui refuse l’oubli, un éclat de lumière dans les ténèbres du mensonge. Et tant que cette voix résonnera, tant que ce flambeau brillera, le peuple ne sera jamais sans avenir. À travers le tumulte des actualités nationales et internationales, les journalistes observent, relèvent les faits et les traduisent en récits, non seulement pour informer mais aussi pour éclairer. Leur rôle dépasse le simple témoignage : ils analysent, mettent en perspective, et rappellent aux peuples le courage nécessaire pour défendre les droits, les libertés et la souveraineté qui forgent l’âme d’une nation. Dans un monde où l’économie globale impose ses lois invisibles, où les systèmes sans nom dictent leurs règles, chaque pays cherche à préserver son identité et son destin. Les intérêts divergents dans les sous-régions dressent des murs, mais la réalité des peuples demeure : infrastructures insuffisantes, industrialisation inachevée, dépendance persistante aux matières premières brutes. Pourtant, c’est dans la transformation locale, dans la création de valeur ajoutée et d’emplois, que réside la clé d’un avenir libre et prospère. L’Afrique, riche de son histoire et de ses ressources, doit regarder hier pour comprendre, agir aujourd’hui pour transformer, et bâtir demain avec audace. Car au cœur de cette renaissance, il y a sa jeunesse. Une jeunesse qui rêve, qui invente, qui aspire à un horizon où le sport devient école de discipline, de solidarité et de dépassement de soi. Une jeunesse qui transforme les défis en force créatrice et place l’Afrique au centre du monde.
Hier fut le temps des luttes. Aujourd’hui est celui des choix. Demain sera celui des victoires. Voici le Mali, berceau de civilisations antiques, où le verbe du journaliste devient témoin et gardien des valeurs. À l’heure où le tumulte du monde secoue nos terres, l’homme de plume et de parole ne se contente pas de rapporter : il éclaire sans blesser, il révèle sans détruire. Car son art n’est point d’ébranler la famille, le travail, la tradition, mais de les mettre en dialogue avec l’avenir. Quelle est sa force ? C’est la délicatesse, oui, la finesse de l’esprit qui sait peser chaque mot comme un orfèvre polit sa pierre. Quelle est sa stratégie ? C’est la vigilance, la capacité d’ouvrir les fenêtres sur le monde tout en gardant la porte close aux vents qui menaceraient notre dignité. Le journaliste au Mali ne doit point être un simple écho des puissances lointaines, mais la voix de son peuple, de ses villages, de ses villes, de ses silences mêmes. Et qu’on ne croie pas que le village soit une relique ! Non, c’est la racine, la matrice, l’école première des savoirs. Si les grandes métropoles, orgueilleuses et bruyantes, cherchent à dicter le rythme du monde, le village, lui, porte l’harmonie du temps long, la mémoire et l’âme. Or, sans racine, la ville n’est qu’un mirage. Et sans la sagesse du terroir, la modernité s’égare dans son propre vacarme. Ainsi, la mission des journalistes, au cœur du Mali, au cœur de l’Afrique, est double : écouter le murmure du village et porter la clameur des cités, unir la tradition et l’innovation, faire que la parole circule comme le fleuve Niger, vaste, patient, fécond. Car la civilisation ne se défend point par la fermeture, mais par l’échange éclairé, où le savoir et le métier se croisent, où le peuple et le monde dialoguent, sans jamais renier ce que nous sommes. Le théâtre vivant de notre temps : un Mali qui se construit entre mémoire et avenir, un peuple qui parle, et des journalistes qui, tels de nobles dramaturges, donnent à cette voix une scène et un écho. Ô cité moderne, ô ville haletante, toi qui fais rouler des flots de deux-roues et de véhicules comme un fleuve sans fin, écoute ! Car au détour des rues, ce n’est plus le chant des marchés que l’on entend, mais le cri des sirènes, le fracas des chocs, le silence tragique des corps blessés.
Le journaliste, ce veilleur des temps, observe, écrit, dénonce — mais il n’est point magicien ! Il ne peut contenir à lui seul le tumulte de la route, la fureur des moteurs, la densité des foules qui s’élancent sans casque, comme si la vie n’était qu’un pari. Hélas, combien d’accidents, combien de jeunesses brisées, combien de familles plongées dans le deuil pour un simple oubli de protection ! Le casque, n’est pas un luxe, ce n’est point un caprice : c’est la citadelle fragile qui protège la tête, le temple de la pensée. Refuser le casque, c’est défier la mort à chaque carrefour. Et la société, si elle se tait, devient complice de son propre malheur. Mais que fait l’urbanisme, dans ce théâtre du quotidien ? Il dresse ses routes comme des arènes, il offre ses avenues aux foules pressées, et les marques, avides de victoire, vendent vitesse, puissance et éclat, sans jamais vendre prudence. La consommation exalte la machine, mais qui exaltera la santé ? Qui placera l’humain avant le produit ? Ô jeunesse africaine, toi qui portes l’avenir, entends ! La liberté n’est point dans la chute, mais dans la discipline ; le courage n’est pas dans l’imprudence, mais dans la sagesse. Porte ton casque comme un drapeau, chevauche ton véhicule comme un conquérant, mais sois le gardien de ta propre vie, avant d’être victime de la vanité des foules. Ainsi doit parler la cité moderne, ainsi doit écrire le journaliste : non pour flatter les passions, mais pour sauver des vies. Car l’urbanisme véritable n’est point dans la pierre seule ni dans l’asphalte, mais dans le pacte entre sécurité et dignité. Et là où la société ferme les yeux, que la plume s’élève, hostile, sublime, impérieuse ! Voyez ce monde effervescent, ce théâtre infini où chaque acteur joue sa partition : l’artisan à son établi, le cultivateur dans ses champs, l’éleveur gardant ses troupeaux, le pêcheur lançant ses filets, le forgeron domptant le feu. Chacun est une note, et tous ensemble composent la grande symphonie du travail.
Or, qui donc recueille cette musique multiple, qui la traduit en récit pour que la nation entière en entende l’écho ? C’est le journaliste, ce messager moderne, ce témoin infatigable. Mais, hélas ! quelle tâche titanesque ! Dans les métropoles, il affronte l’administration lourde et sourde ; dans les campagnes, il court après la vérité qui se cache derrière les sillons et les marchés. Entre les deux, il doit bâtir la passerelle invisible qui relie le marteau du forgeron au clavier de l’ordinateur, la houe du paysan aux tours de béton de la ville. Et qu’on ne s’y trompe point : la télévision et la radio ne suffisent plus ! Le temps réel, ce tyran moderne, exige que l’information coule sans pause, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tel un fleuve sans rive. Le journaliste doit être sportif, oui, sportif de l’esprit et du corps, courant, écrivant, interrogeant, vérifiant, comme un coureur sans repos dans la grande arène de la vérité. Mais quelle cruauté, ô siècle moderne ! Tu demandes l’impossible, tu veux des voix partout, à chaque instant, et tu oublies que derrière chaque mot, chaque image, il y a un être de chair et de fatigue. Tu dresses l’information comme une idole insatiable, et les peuples s’y prosternent, sans voir que ses prêtres s’épuisent à nourrir la flamme. Ainsi, au cœur de ce monde contemporain, hostile et vorace, la mission du journaliste est sublime : il doit unir les voix dispersées, donner au travailleur de la campagne la même dignité qu’au citadin, transformer les métiers en mémoire vivante, et rappeler à la cité que la vérité n’est pas un spectacle, mais un bien commun. Ô information, tyrannie et trésor, temple et labyrinthe, que celui qui t’embrasse se garde d’y perdre son âme ! Les journalistes sont au seuil des scènes, ils recueillent les éclats du théâtre et de la comédie, ils guettent la palpitation d’un spectacle, ils gardent mémoire du tumulte des festivals, ils portent les voix des lieux où la culture s’élève. Ils traversent les salles, les coulisses, les conférences, ils croisent les regards d’artistes venus des quatre vents, ils dressent le portrait du monde dans ses habits de fête ou de douleur. Mais eux-mêmes, qui les regarde ? Ils ne sont ni acteurs ni musiciens, et pourtant, ils composent une musique d’encre et de papier. Ils ne sont ni juges, ni marchands, et pourtant leur plume distribue l’éclat sans peser d’or. Ils donnent l’information comme on tend une coupe d’eau au passant assoiffé : sans calcul, sans prix, mais avec le souci de la clarté, avec la rigueur de ceux qui savent que l’art est fragile et que la culture ne vit que si elle est partagée.
Ô journalistes, vous êtes à la fois témoins et passeurs, à la fois ombre et lumière. Votre tâche n’est pas d’applaudir ni de condamner, mais de révéler. Et dans cet acte, vous devenez complices du poète, frères du comédien, des artistes contemporains, hostiles à la fadeur, alliés de la vérité, amants de la beauté.
Yé Lassina Coulibaly art et culture,
Site officiel : www.yecoulibaly.com
Artiste auteur-compositeur interprète
Musicothérapie sociétaire de la SACEM, ADAMI, SPEDIDAM, Union des Artistes Burkinabés
Chevalier de l’Ordre du mérite, des lettres et de la communication (agrafe musique et danse) du Burkina-Faso (concert, spectacle, pédagogie). Tel : 00 336 76 03 71 66