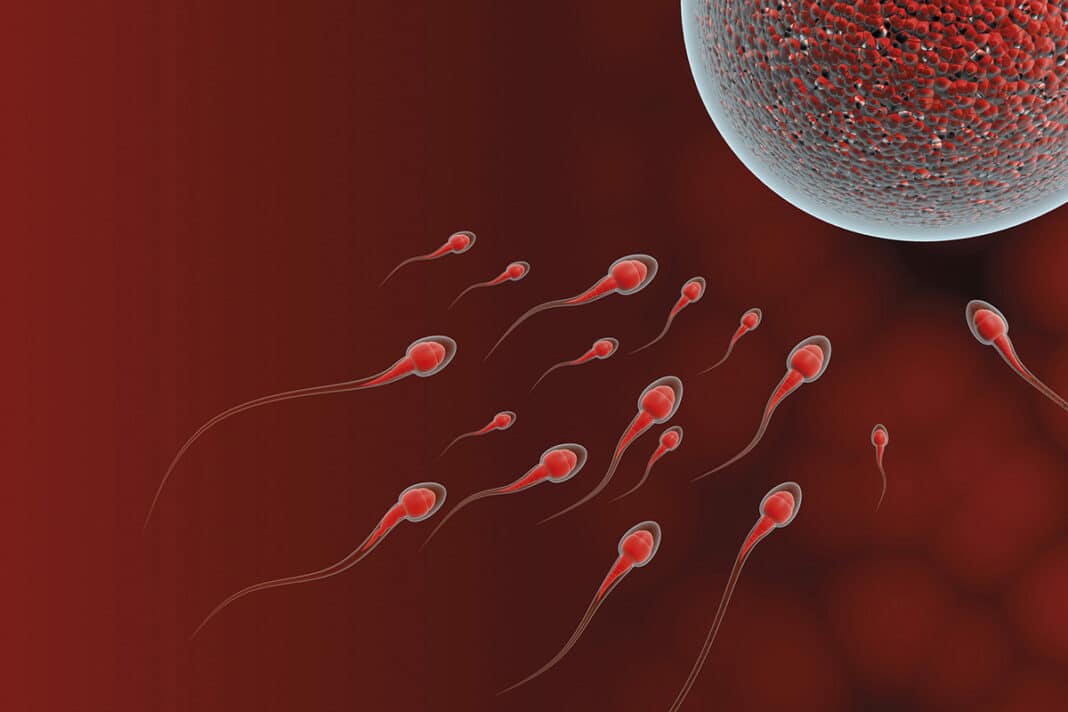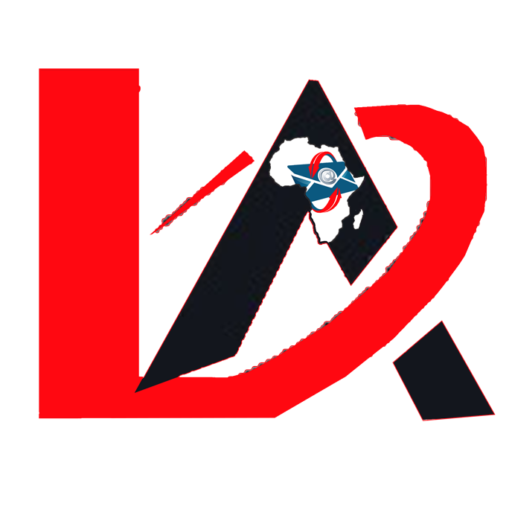(LETTRE D’AFRIQUE) L’infertilité reste un sujet sensible et souvent tabou particulièrement dans la société malienne et en Afrique de façon générale. Si elle touche aussi bien les hommes que les femmes, ce sont généralement les femmes qui en subissent les conséquences sociales les plus lourdes : stigmatisation, rejet, isolement, voire violences conjugales. À l’heure où les chiffres alertent et les témoignages se multiplient, des voix s’élèvent pour briser les tabous et appeler à la solidarité des couples face à ce problème de santé publique.
Un problème médical, pas une fatalité morale
L’infertilité est définie par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme l’incapacité d’un couple à obtenir une grossesse après 12 mois ou plus de rapports sexuels réguliers non protégés. Selon les données disponibles, 15 à 17 % des couples maliens seraient concernés. Pourtant, le sujet demeure entouré de mythes, de honte et de silence, particulièrement pour les femmes.

« Les causes de l’infertilité peuvent être multiples, et concernent autant les hommes que les femmes », rappelle Dr Moussa Balla Coulibaly, gynécologue à la clinique La Vie de Banconi. Parmi les causes fréquentes chez les femmes en Afrique : les infections non traitées, les avortements pratiqués dans de mauvaises conditions, et les accouchements à risque.
Des traitements possibles mais peu accessibles
Les techniques de procréation médicalement assistée (PMA), comme la fécondation in vitro (FIV), représentent une solution pour de nombreux couples. Au Mali, des cliniques spécialisées comme le Centre Diafounou à Bamako, fondé en 2012, ont déjà permis à des centaines de couples d’avoir des enfants. Selon Dr Bandjougou Doucouré, promoteur du centre, plus de 80 % des couples ayant eu recours à la PMA ont pu concevoir.
Cependant, le coût élevé des traitements, souvent entièrement à la charge des patients, constitue un frein majeur, en particulier dans un pays à faibles revenus. Beaucoup de familles se retrouvent dans des situations financières critiques, parfois poussées à la pauvreté en tentant d’avoir un enfant.
Une stigmatisation injuste et destructrice
Dans la culture malienne, la pression sociale autour de la maternité reste très forte. Une femme qui ne parvient pas à enfanter est souvent accusée, rejetée ou marginalisée, alors même que dans près de 50 % des cas, l’infertilité est d’origine masculine.

« En Afrique, une femme sans enfant peut être isolée, déshéritée ou agressée. Dans certains cas, cela mène au divorce ou à des violences physiques et psychologiques », alerte Ernestine Gwet Bell, gynécologue camerounaise spécialisée en infertilité.
Cette stigmatisation sociale pousse de nombreuses femmes dans une profonde détresse émotionnelle, aggravée par l’absence de soutien du conjoint ou de la famille.
Briser les mythes, changer les mentalités
Des campagnes de sensibilisation, telles que « Plus qu’une mère » lancée par la Fondation Merck, visent à changer les mentalités en Afrique. Pour le Dr Rasha Kelej, PDG de la fondation, il est urgent de mettre fin à la culpabilisation injuste des femmes et de promouvoir une vision plus solidaire, humaine et médicale de l’infertilité.
« Briser la stigmatisation liée à l’infertilité, en particulier chez les femmes, a été l’objectif principal de notre campagne emblématique », affirme-t-elle.
Sensibiliser, consulter, accompagner
Les autorités sanitaires maliennes, accompagnées par des organisations de la société civile, mènent également des actions d’information pour promouvoir le dépistage en couple et le recours aux spécialistes en fertilité. Une approche inclusive et responsable est nécessaire pour éviter que l’infertilité ne soit vécue comme un drame personnel, mais plutôt comme un défi médical pouvant être pris en charge.

« Faites-vous dépister avec votre épouse, soutenez-la pendant le traitement. L’infertilité n’est pas une faute, et elle concerne autant les hommes que les femmes », insistent les messages de sensibilisation diffusés dans le pays.
Vers une prise de conscience nationale
Alors que plus de 180 millions de couples dans les pays en développement souffrent d’infertilité, selon l’OMS, le besoin d’un changement culturel devient pressant. Pour S.E. Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, Première Dame de la RDC et ambassadrice de la campagne « Plus qu’une mère », ce changement doit passer par l’éducation, l’information et le courage de parler.
Briser le silence sur l’infertilité, c’est faire un pas vers une société plus juste, plus solidaire et plus humaine.
Bréhima Traoré