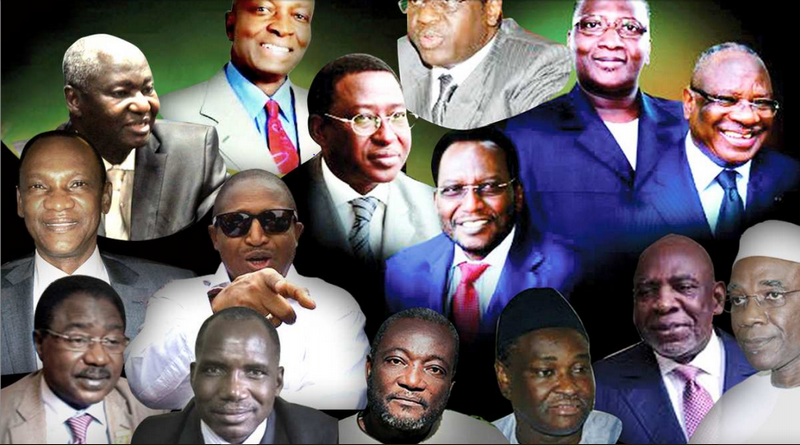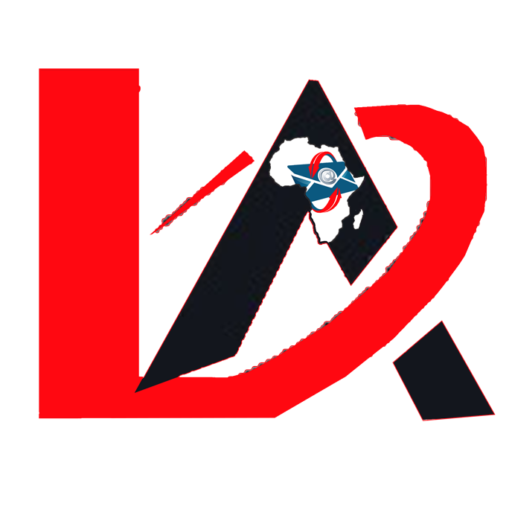L’instauration de la démocratie multipartite dans notre pays suite à l’insurrection populaire ayant débouché sur le coup d’Etat du 26 mars 1991, a provoqué une floraison tous azimuts de partis politiques. Celle-ci, sous le couvert du multipartisme intégral homologué par la conférence nationale organisée dans la foulée du renversement du régime militaro-civil de l’UDPM, sera marquée par une gestion patriarcale et paternaliste de la part des dirigeants qui restent collés à leurs postures comme des dinosaures depuis trois dizaines d’années. Leur temps est pourtant bien révolu, non pas seulement en raison de leur durée sur la scène, mais surtout parce qu’ils ont échoué à instaurer une véritable démocratie vertueuse. Et pourtant, beaucoup d’entre eux ne se rendent pas compte, ils osent toujours se glorifier de leur gestion et sont décidés à occuper la scène nationale.
Le Général Yamoussa Camara, ministre malien de la défense pendant la transition de 2012-2013, dans son livre « Présumé coupable, ma part de vérité » affirme que : « L’homme politique malien dévoile sa vraie nature à l’exercice du pouvoir. Vaniteux et tyrannique, il est singulièrement cruel. En dehors des siens, qu’il aime jusqu’à leurs défauts, nul ne trouve grâce à ses yeux. Aveuglé par son désir de puissance et enchaîné dans ses appétits, ses besoins et ses passions, il oublie les principes moraux et la certitude de la mort. Il reste suprêmement indifférent à l’arbitraire et à l’injustice pour tout ce qui ne le touche pas. » . Malheureusement c’est ce constat qui se dégage en faisant une rétrospective sur les 30 années de pratique démocratique dans notre pays. Les acteurs du mouvement dit démocratique ont suscité un réel espoir chez les populations. Hélas, cela ne fut que de courte durée car les maliens se sont rendus compte progressivement que les hommes politiques ne pensaient qu’à eux-mêmes, à leurs familles, à leurs amis et proches. L’exercice du pouvoir est devenu un partage de gâteau entre les politiques ouvrant ainsi la course effrénée à l’enrichissement. La politique est devenue un ascenseur pour se hisser dans la société.
Création tout azimut de partis politiques au gré des situations
Tout a commencé après la chute du régime du Général Moussa Traoré le 26 mars 1991 et avec la naissance des premiers partis politiques comme le PDJ (Parti pour la Démocratie et la Justice), première formation ayant reçu son récépissé en tant que parti politique légalement constitué après les évènements de mars 1991), l’ADEMA-PASJ (Alliance pour la Démocratie au Mali-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice), le CNID-Faso Yiriwa Ton (Congrès National d’Initiatives Démocratiques), le PDP (Parti pour la Démocratie et le Progrès), etc. Chose remarquable et épisode singulier d’un temps, à l’issue délections non contestées, les Maliens confièrent les rênes de l’Etat et de la République (et aussi de la nouvelle démocratie conquise au prix fort) à un premier président de la République démocratiquement élu au suffrage universel (pour la première fois) en la personne d’Alpha Oumar Konaré (AOK). Ce premier président, auréolé de la nouvelle ère démocratique multipartite, incarnation du nouvel espoir après trente-un ans d’indépendance nationale (08 ans sous l’US-RDA et 23 ans de régime CMLN-UDPM), était le candidat de l’ADEMA-PASJ où se retrouvait, en quelque sorte, la crème combattante pour la démocratie. Pour mettre en place son gouvernement, AOK proposa à la classe politique un pacte accepté par certains partis politiques comme l’US-RDA (Union Soudanaise-Rassemblement Démocratique Africain), le PDP (Parti pour la Démocratie et le Progrès), le RDP (Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès), le RDT (Rassemblement pour la Démocratie et le Travail), etc., d’où l’appellation des « Partis Politiques Signataires du Pacte Républicain » (PSPR). C’est ainsi que des portefeuilles ministériels furent attribués à ces alliés. Au même moment, d’autres partis politiques se rassemblèrent en un Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD) pour former une opposition animée par le CNID, l’UDD (Union pour la Démocratie et le Développement), une dissidence de l’US RDA, le BDIA (Bloc Démocratique pour l’Intégration Africaine), le PSP (Parti Progressiste Soudanais), etc.
Les troubles scolaires intempestifs ne tarderont pas à perturber l’évolution de la nouvelle gouvernance ; ils conduisirent AOK à changer fréquemment de gouvernement. Les évènements de février 1994, au cours desquels une partie de l’Assemblée nationale, des domiciles de dignitaires de l’ADEMA et de l’US-RDA ont été saccagés par des manifestants élèves et étudiants, obligèrent AOK à ouvrir le gouvernement aux opposants. Le CNID, principale force politique de l’opposition d’alors, fit son entrée dans le gouvernement à travers deux portefeuilles ministériels occupés par Abdoulaye Diop et Me Amidou Diabaté nommés respectivement ministre chargé des mines et ministre en charge de la justice. Quelques temps après, cette alliance vola en éclats avec des conséquences fâcheuses pour le CNID qui sera fissuré à travers le départ de certains de ses cadres qui créèrent un autre parti politique, le PARENA ( Parti pour la Renaissance Nationale).
A la même période, Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), nommé Premier ministre, fut élu président de lADEMA-PASJ. Ce qui ne fut pas du goût de certains pères fondateurs comme feu Pr. Mamadou Lamine Traoré, qui assurait jusque-là la vice-présidence dans la Ruche. Avec certains camarades, il démissionna de l’ADEMA-PASJ pour créer le MIRIA (Mouvement pour l’Indépendance, la Renaissance et l’Intégration Africaine). Au même moment, des dissidents du PDP porteront sur les fonts baptismaux la Convention Social-Démocrate (CDS). Dans la même veine, des révoltés de l’UDD donneront naissance au MPR (Mouvement Patriotique pour le Renouveau), nouveau parti politique qui afficha d’emblée et sans ambiguïté sa volonté de revendication de l’héritage de la défunte UDPM du Général Moussa Traoré. Cest dans cette situation marquée par des déchirements politiques qu’arriva à terme le premier mandat d’AOK. L’obtention de son second mandat se fera dans des circonstances douloureuses en 1997. En effet, avant l’élection présidentielle, le pouvoir organisa, avec l’appui d’une Commission Nationale Electorale Indépendante (CENI) dirigée par Me Kassoum Tapo, les élections législatives en avril 1997 qui se soldèrent par un fiasco, le plus grand et le plus retentissant ratage électoral de l’histoire politique du Mali depuis les indépendances africaines. Les résultats, on s’en souvient comme si ce nétait quhier tout près, ont été rejetés par la majorité de la classe politique. Ce fiasco électoral du 13 avril 1997 ne quitte, d’ailleurs, pas les esprits des Maliens et il est peu probable qu’il s’efface des mémoires sur plusieurs générations : les fameuses législatives ont occasionné rien de moins quun gigantesque gouffre financier, et on ne connaîtra peut-être jamais le montant exact du gâchis. L’occasion a, d’ailleurs, été tout trouvée à lépoque par la classe politique opposée à AOK pour créer un regroupement dit Collectif des Partis Politiques de lOpposition (COPPO) présidé par le doyen des présidents de partis politiques en la personne de feu Almamy Sylla, président du RDP. Le choix de ce dernier d’être dans l’opposition amena certains de ses lieutenants à créer un nouveau parti politique, le RND (Rassemblement National pour la Démocratie). Le COPPO composé du RDP, du CNID, du MIRIA, du BDIA, du MPR, du PSP, du PUDP (Parti pour lUnité, la Démocratie et le Progrès), du Mouvement politique SADI (Solidarité Africaine pour la Démocratie et lIndépendance), etc. décida de boycoter toutes les échéances électorales, à commencer par la présidentielle quil a disputée avec Feu Mamadou Maribatrou Diaby du PUDP, celui-ci ayant quitté ses camarades du COPPO pour la circonstance. Malgré tout, AOK organisera tous les scrutins, non sans faire arrêter et emprisonner tous les leaders du COPPO, à lexception notoire de Choguel Kokala Maïga du MPR. Profitant du bâillonnement des ténors de lopposition, dautres partis politiques surgirent des ténèbres et se firent appeler « Opposition Républicaine ». Ces derniers participèrent à tous les scrutins, certains portés par lADEMA-PASJ, pour atterrir dans les mairies et dans lhémicycle. Ils siègeront aussi au gouvernement dans le cadre dune convention signée avec lADEMA-PASJ. Ainsi, des cadres du PARENA, de lUDD, de l’US RDA, de la COPP (Convention Parti du Peuple) et autres entrèrent dans le gouvernement. Pr. Yoro Diakité du PARENA devint même, pendant longtemps, le numéro deux du gouvernement en qualité de ministre d’Etat chargé de lénergie. Quant à Me Amidou Diabaté, il revint au département de la justice, cette fois-ci au nom du PARENA. Pr Younouss Hameye Dicko et Aboubacary Coulibaly de l’UDD occupèrent respectivement les départements des enseignements secondaire et supérieur et celui en charge de l’hydraulique. Mme Ascofaré Oulématou Tamboura de la COPP, pour sa part, occupa le ministère de la communication, etc. Ce fut dans une atmosphère de non reconnaissance des institutions par le COPPO quAOK fit son second mandat à la tête du Mali ; toutes les tractations possibles nont pu changer cette donne. Vers la fin de son second mandat, à deux ans près, AOK, par une pression constante, oblige IBK à se démettre de ses fonctions de Premier ministre, au prétexte exhibé quil doit aller soccuper du parti pour préparer léchéance majeure de la présidentielle de 2002. Mais à la tête de lADEMA, IBK sera vite décrié, souffrira dun complot contre lui, et il finit par démissionner pour aller créer, après moults péripéties dont un moment dexil, son parti, le RPM (Rassemblement pour le Mali). Mais il faut signaler que cétait à la veille des élections de 2002, quil sera dabord créé, avec le soutien dune grande partie de ses adversaires d’hier du COPPO, un mouvement polimtique dénommé « ESPOIR 2002 ». Fort de cet appui, il se présenta à l’élection présidentielle en 2002 qui fut remportée par Feu Amadou Toumani Touré (ATT), grâce à lévidente bénédiction du président sortant, AOK. IBK est néanmoins arrivé troisième, derrière le candidat de lADEMA-PASJ, feu Soumaïla Cissé. Ce dernier a considéré, pour des raisons fort plausibles dailleurs, que son échec est dû à une trahison de certains camarades de son Parti. Furieux, il décida, en compagnie de beaucoup de ses fidèles, de quitter le navire ADEMA pour créer un nouveau parti politique : l’URD (Union pour la République et la Démocratie).
Partage de gâteau entre tous les partis politiques pendant 10 ans avec ATT
Après une nouvelle alternance à la mode ping pong, Amadou Toumani Touré revient au pouvoir en 2002. Porté à la magistrature suprême par un puissant mouvement citoyen avide dune gouvernance de rupture, ATT se démarquera de ses soutiens originels, une fois aux affaires, en optant pour un mode de gouvernance basé sur le consensus général et mou. Une sorte de « partitocratie » dépourvue de cette boussole programmatique qui donne sens et cohérence à laction publique.
Durant presque dix ans, de 2002 à 2012, sur le plan politique, le Mali ne connaîtra ni de majorité, ni d’opposition. Toute la classe politique s’est tue comme une carpe, car ATT avait « associé tout le monde à la gestion du pays » à travers le slogan fétiche « Gestion consensuelle du pouvoir ». Ce fut le temps du consensus politique béat, hypnotisant et sclérosant. Les postes sont octroyés aux hommes politiques comme à la hussarde, Soumaïla Cissé lui-même est envoyé à la Commission de lUEMOA comme président de cette institution; en fait une manière habile et consentie- de léloigner un temps du pays. Le peuple est resté spectateur et médusé face à cette sorte de prise en otage par un président revenant, tout-puissant, tel un demi-dieu lâché dans larène. Que faire? La solution, c’est de s’en remettre à Dieu, d’où la montée en puissance des leaders religieux musulmans. De fil en aiguille, ceux-ci, au nom de la morale religieuse dont ils sont pour beaucoup les gardiens sans pour autant incarner un quelconque magistère dans la réalité, s’imposent aux politiciens professionnels et deviendront incontournables dans la prise des décisions majeures concernant la vie de la nation. Les populations se sentent de plus en plus laissées pour compte, surtout sur le plan sécuritaire. La gestion laxiste du problème du Nord sonnera le glas du pouvoir dATT. Ainsi, à quelques semaines seulement de la fin de son second mandat, une mutinerie dans le camp de Kati se transforma en coup dEtat et mit fin à son régime. Cétait loccasion inouïe de procéder à un changement générationnel. Hélas, les faucons politiques referont encore surface en donneurs de leçons de démocratie. Ils nont pas hésité à demander à la communauté internationale de prendre des sanctions économiques contre leur propre pays. Quelle leçon de patriotisme! Les jeunes militaires, à lorigine du renversement du pouvoir de consensus dATT, nont pas pu résister à leurs manuvres. Finalement, ils céderont le pouvoir à ces « démocrates insincères ». Et voilà que les compteurs sont remis à zéro ! Cest ainsi quIBK, grâce au concours précieux des jeunes militaires à la base de la chute dATT, accédera à la magistrature suprême.
Un président loin de son peuple à cause de son goût immodéré des dépenses
À peine élu, le président IBK sest acheté un nouvel aéronef. Daprès une étude commanditée par ses services, lavion de commandement utilisé par ses prédécesseurs ATT et Dioncounda Traoré ne serait plus sûr techniquement. Il ny
aura jamais, cependant, une contre-expertise pour corroborer les conclusions de cette étude. Lachat dun avion était-il une priorité pour le Mali qui venait à peine de sortir dune occupation ? De nombreux Maliens ont été déçus par cette décision dun président sur lequel ils fondaient beaucoup despoir. Ce nest pas tout. IBK avait aussi engagé de coûteux travaux dembellissement de lannexe du palais occupée auparavant par son prédécesseur, le président de la Transition, à cause de la destruction partielle du bâtiment principal lors du coup dEtat contre ATT. Cette annexe ne répondait pas trop au goût du nouveau locataire. Par exemple, le carrelage était jugé sommaire, il fallait donc du marbre de haute qualité ! Des milliards engloutis pour donner, aujourdhui, ce qui est sans doute, lun des plus luxueux bureaux de chef dÉtat au monde. Son goût immodéré des dépenses a été une grande faille dans sa gouvernance
Par ailleurs, bien que largement élu à lissue du second tour (77,6 % des suffrages), IBK sera incapable de donner un cap à son gouvernement. Même parmi ses collaborateurs, on admet que le plus important pour lui nétait pas de diriger, mais de trôner. Il laisse faire son entourage, composé en grande partie de sa famille. Très vite, les scandales financiers se multiplient de même que les gouvernements : IBK a changé quatre fois de premier ministre en lespace de quatre ans
Mal réélu lors de son second mandat, IBK change de casting ministériel, mais pas de méthodes. La situation sécuritaire empire dans le centre, où les massacres se multiplient. Elle stagne au nord. Et à Bamako, les scandales politico-financiers nen finissent pas de faire les unes des journaux. Incapable de sen sortir, il mise sur Soumeylou Boubèye Maïga comme Premier ministre. Celui-ci est contraint à la démission en avril 2019 après plusieurs manifestations populaires. Il est remplacé par Boubou Cissé qui décida douvrir le gouvernement qui a été accueilli favorablement par des opposants qui en avaient marre de se voir laissés pour compte par IBK. C’est ainsi que des hommes politiques comme Tiebilé Dramé, Oumar Hamadoun Dicko entreront dans l’équipe gouvernementale. Malgré tout, les contestations populaires organisées par le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), une coalition hétéroclite de partis politiques, dorganisations de la société civile, finiront par affaiblir IBK, permettant ainsi, le 18 août 2020, à un quarteron de jeunes colonels de larmée de prendre le pouvoir.
Cest ce spectacle politique dune trentaine dannées que les acteurs du mouvement démocratique a présenté au peuple malien./.
Par Sidi Modibo Coulibaly
Spécialiste en communication et gestion des connaissances Tel.63 36 81 31