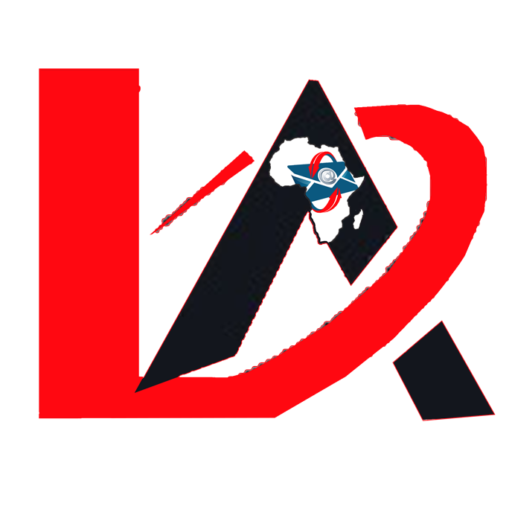Dans le cadre de la célébration du mois des personnes d’ascendance africaine, cette année les organisateurs ont mené des innovations. Ils ont saisi l’occasion de présenter et animé par Mme Lollita Dandoy un défilé de mode sur la nouvelle collection de mode de « la Nouvelle Route du Coton », intitulée « se vêtir, être et paraitre ». C’était le 18 février 2023 à la Chaufferie de l’ESG-UQAM, au Canada. La nouvelle route du Coton est une initiative de valorisation du Coton du Mali, fondée sur des savoirs et des savoir-faire qui rendent compte des talents et de la créativité artistique des artisans, designers, créateurs de mode et décorateurs, maliens et canadiens. Elle a vu le jour sous la clairvoyance et le leadership de SEM Fatima Braoulé Meïté, ambassadeur du Mali au Canada et non moins Représentante permanente auprès de l’OACI. Nous vous livrons l’intégralité du texte de Mme Fatima B. Meïté. Lisez !
La Nouvelle Route du Coton symbolise le patrimoine culturel malien dans le domaine du textile, de la mode et de la décoration intérieure. Les produits sont fabriqués avec des ressources durables sourcées, notamment auprès des agricultrices cultivant le coton, des teintures naturelles à base de terre, d’écorces et fabriquées à la main par des artisans, des créateurs de mode et les autres acteurs de la transformation et de la chaîne de valeur du coton du Mali.
Pour le malien, se vêtir est plus qu’un acte de protection, mais aussi un mode d’expression de son identité. En effet, les vêtements textiles faits à la main, à partir de coton naturel et teints avec des teintures végétales et de la terre, conçus à partir de nos savoirs et savoir-faire traditionnels, transmis de génération en génération, lorsque portés, constituent une seconde peau, notre seconde peau.

L’acte de tisser et de transformer le coton représente non seulement notre histoire, nos mémoires, nos repères et donc notre « moi », notre « être », mais aussi notre « nous ». Car dans les heureuses, comme dans les tristes occasions, le coton constitue les liens entre les membres de notre communauté et est notre allié dans notre cycle de vie, de notre naissance à notre mort.
En effet, les mères louaient les services des Maabo, tisserands par traditions pour confectionner des couvertures et des pagnes pour constituer le panier de la mariée. Il en était de même pour constituer le trousseau du nouveau-né. Enfin, le coton constitue le dernier vêtement que nous portons comme linceul à notre mort.
Aujourd’hui nous assistons à la disparition des Maabo, mais également des tisserands et des transformateurs textiles de toutes les cultures du Mali. Ceci s’explique d’abord par le fait que les femmes ont remplacé les tissus tissés à la main par des tissus industriels et importés. Ce qui a poussé bon nombre d’entre eux à l’exode vers Bamako dans les années 80. Et cela est aussi exacerbée par le changement climatique qui a entrainé la rareté des intrants naturels dans la production (herbes, écorces d’arbres, rareté de l’eau etc…), l’extrémisme violent et le terrorisme.

Le coton constitue une part importante de notre avenir économique. En 2022, le Mali fut le premier producteur de coton en Afrique avec une production de produit 810 000 tonnes. Cependant, il transforme à peine 2% de sa production en produits finis, car destinée à l’exportation. Cela se traduit par un manque à gagner en termes d’opportunités de création d’emplois sur les chaînes de valeur du secteur, en particulier pour les femmes et les jeunes, et également pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) et en faire une solution durable à de nombreuses fins.
Comment le Mali peut-il se réapproprier le patrimoine culturel sur la transformation du coton et comment et pourquoi doit-il passer du local au global dans le secteur du textile et de la mode ? Telles sont les questions auxquelles la Nouvelle Route du Coton dans le cadre de son programme de promotion des textiles du Mali, apporte des éléments de réponses.
La nouvelle Route du Coton, à l’image du concept de « la Route de la Soie » se propose de tisser et de renforcer les liens de partenariats culturels, économiques, diplomatiques. etc… entre le Mali et le Canada, le long du fil du coton. Enfin, la Nouvelle Route du Coton à travers les outils que le numérique nous offre, est une opportunité sans précédent pour l’innovation et la créativité dans ce secteur.
La collection « se vêtir, être et paraitre », symbolise tout cela, notre quête individuelle et collective de se vêtir non seulement pour se protéger, mais aussi de (re)trouver et, pour afficher notre identité, paraitre et être tel que nous sommes et comme l’on est, malgré toutes nos différences, et enfin d’exister dans un monde qui se veut de plus en de plus mondialisé et uniformisé, dans un contexte mondial de surproduction et de surconsommation, aujourd’hui de plus en plus remis en cause.
Du local au global, du Mali au monde, chaque jour des hommes et des femmes, notamment des jeunes de la nouvelle génération, protègent et perpétuent cette tradition fondée sur le développement durable et l’économie circulaire pour créer des emplois durables tout en préservant l’environnement, les savoirs et les savoirs-faires ancestraux.
Ces concepts aujourd’hui de retour, ne nous sont pas nouveaux, car ils constituent notre mode de vie qui pendant longtemps a été considéré comme rétrograde, mais qui en fait est une forme de préservation d’un mode de vie qui perpétue le fondement même de notre être et une résistance face à ce qui ne nous paraissait pas naturel et dans l’ordre des choses.

Ce secteur porté par les jeunes, les hommes et les femmes du champ de coton à la création du vêtement sur la chaine de valeur, est créateur d’emplois et d’espoirs. En effet, si aujourd’hui avec le mouvement « Black Live Matter », de nombreux emprunts sont faits de la culture africaine dans le domaine de la mode et des industries créatives, force est de constater que cela ne bénéficie pas aux personnes d’ascendance africaine. Elles sont, soit mannequins, soit fournisseurs de matières, mais rarement en première ligne comme créatrices ou propriétaires d’une marque de vêtement connue et promue, car cela requiert des moyens techniques, financiers et des réseaux dont elles ne disposent pas.
Ce programme s’inscrit parfaitement dans le thème du mois des personnes d’ascendance africaine de cette année 2023 au Canada « A nous de raconter», qui est une réappropriation de notre narratif de qui sommes-nous ? d’où venons-nous ? Et comment nous nous projetons dans le futur ? Un futur conté par nous-même.
Il s’inscrit également dans la mise en œuvre de la stratégie de diplomatie culturelle de mon ambassade, celle de la République du Mali au Canada, que nous avons commencé à décliner en 2020. Maaya: Culture, Mémoires, Repères et créativités, qui vise à contribuer à la préservation et à la valorisation du Patrimoine culturel matériel et immatériel malien. « Maaya » qui symbolise l’humanisme en langue Bambara, se propose de valoriser les référents culturels que le Mali a en partage avec ses communautés et avec le monde. « Maaya » peut être défini comme un ensemble de valeurs morales et spirituelles qui font d’un individu un être social et sociable.
Mes pensées vont à l’endroit de mes deux sœurs qui sont en première ligne de ce combat mais qui n’ont pas pu avoir leurs visas pour venir participer à ce défilé.
Par: SEM Fatima Braoulé MEITE, Ambassadeur de la République du Mali au Canada